Nicolas Roumiantzoff
Nicolas Roumiantzoff, aristocrate russe (comte), né le à Yanovka en Russie et mort le au Val-de-Grâce à Paris en France, est un officier de l'armée de terre française, notamment de la Légion étrangère, de 1926 à 1962.
| Nicolas Roumiantzoff | |
| Naissance | Yanovka, Russie |
|---|---|
| Décès | (à 81 ans) Paris, France |
| Origine | |
| Arme | Légion étrangère |
| Grade | général |
| Années de service | 1926 – 1962 |
| Commandement | 4e Régiment de chasseurs d'Afrique Groupement mobile n°3 (Tunisie) et n°7 (Saarburg) |
| Conflits | Seconde Guerre mondiale Algérie - Indochine |
| Distinctions | Légion d'honneur Compagnon de la Libération Croix de guerre 1939-1945 Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs Il totalise 22 citations |
Fils d'un général de cavalerie de l'armée du Tsar, contraint de quitter la Russie lors de la révolution de 1917, il trouve refuge auprès de sa grand-mère en Bretagne (France).
Entre-deux guerres
Nicolas entre à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1924 à titre étranger. Il en sort sous-lieutenant (promotion du Rif) en 1926. Il est alors affecté à la Légion étrangère et sert au 1er régiment étranger de cavalerie, en Tunisie tout d'abord (1927-1929) puis au Maroc (1929-1935). Lieutenant en 1928, il reçoit, en 1932, le commandement du 3e escadron des cavaliers Tcherkesses en Syrie (1932-1935). De nouveau affecté au 1er REC en 1936, d'abord au Maroc puis en Tunisie, il obtient la nationalité française en 1939.
Seconde Guerre mondiale
En avril 1940, il participe, avec son escadron à cheval, à la campagne de France, au sein du groupement de reconnaissance divisionnaire no 97 (GRD 97). Blessé le , il est fait prisonnier. Il s'évade puis, après l'armistice, est de nouveau affecté au 1er REC, au Maroc. Incarcéré à Ceuta pour avoir essayé de rejoindre la France libre, il s'évade puis rejoint les « Français libres » à Londres.
Promu au grade de capitaine, il est affecté à l'état-major du général De Gaulle. En 1942, il débarque à Beyrouth et devient commandant en second du Groupement de reconnaissance de corps d'armée (GRCA), unité qui deviendra plus tard le 1er Régiment de marche de Spahis marocains. Il est de nouveau blessé en août 1942 en Libye. Il se distingue ensuite au combat de l'Himeimat lors de la bataille d'El Alamein. Chef d'escadrons en 1943, il s'illustre en Tunisie au combat de l’oued Gragour, où il bloque l'offensive de Rommel. Il est intégré avec son unité à la « force L » du général Leclerc. Le , il est décoré de la croix de la Libération par le général De Gaulle.
Il rejoint la 2e division blindée et fait mouvement vers l'Angleterre avec son unité, le régiment de marche des spahis marocains, en mai 1944. Promu lieutenant-colonel en juin de la même année, il débarque en Normandie le , avec la 3e armée américaine. Il est le premier, avec son groupement léger, à atteindre la place de l'Étoile, à Paris, le . Poursuivant les combats en France, il devient chef d'état-major de la 10e division d'Infanterie fin septembre 1944.
Indochine et Afrique du Nord
À l'issue de la guerre, il est affecté au cabinet militaire du ministère de la défense, puis, après un bref séjour à Beyrouth, rejoint l’Indochine en 1948 en qualité de commandant du secteur de Quang-Tri. En janvier 1949, il est blessé une troisième fois. En octobre de la même année, il prend le commandement du secteur est du Cambodge. En 1950, Nicolas Roumiantzoff prend le commandement du 4e Régiment de Chasseurs d'Afrique (4e RCA), dans le sud tunisien. En 1953, il est promu au grade de colonel et sert de nouveau en Indochine, où il commande le groupement mobile n°3.
En 1955, il commande le groupement mobile n°7 à Saarburg (Allemagne) avant de rejoindre l'Algérie pour y être affecté au commandement du secteur d'Aflou. De retour en métropole, le colonel Roumiantkoff est affecté à l’état-major de la 8e Région militaire et prend, en 1961, le commandement de la subdivision de Chambéry.
Titulaire de 22 citations dont 11 à l’ordre de l’armée, il est inscrit à la liste et nommé en 1re section des officiers généraux général de brigade en janvier 1962. Puis, à sa demande, il est affecté en 2e section à partir de juillet de la même année. Retiré à Paris, Nicolas Roumiantzoff meurt à l’hôpital du Val-de-Grâce, le . Ses obsèques ont lieu en l’église Saint-Louis des Invalides. Il est inhumé à Saint-Pierre-de-Rivière dans l’Ariège.
Vie privée
Marié avec le mannequin Pâquerette, il est le père de Nicolas Pierre, qui a rédigé une biographie à son sujet[1].
Décorations
 Grand officier de la Légion d'honneur
Grand officier de la Légion d'honneur Compagnon de la Libération par décret du 2 juin 1943[2]
Compagnon de la Libération par décret du 2 juin 1943[2] Croix de guerre 1939-1945 (10 citations)
Croix de guerre 1939-1945 (10 citations) Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs (5 citations)
Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs (5 citations) Croix de la Valeur militaire avec palme
Croix de la Valeur militaire avec palme Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945
Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945_ribbon.svg.png.webp) Croix du combattant
Croix du combattant_ribbon.svg.png.webp) Médaille coloniale avec agrafes "Libye", "Tunisie 1942-43", "Extrême-Orient"
Médaille coloniale avec agrafes "Libye", "Tunisie 1942-43", "Extrême-Orient" Chevalier de l'ordre du Mérite social
Chevalier de l'ordre du Mérite social Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945
Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre
Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre Médaille commémorative de la campagne d'Indochine
Médaille commémorative de la campagne d'Indochine Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe Algérie
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe Algérie_des_Blesses_Militaires_ribbon.svg.png.webp) Insigne des blessés militaires
Insigne des blessés militaires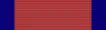 Ordre du Service distingué (GB)
Ordre du Service distingué (GB) Croix militaire (GB)
Croix militaire (GB) Distinguished Service Cross (USA)
Distinguished Service Cross (USA).svg.png.webp) Commandeur du Nichan Iftikhar (Tunisie)
Commandeur du Nichan Iftikhar (Tunisie).svg.png.webp) Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc)
Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc)- Mérite Militaire Syrien
Notes et références
- Philippe Maxence, « Un héros si discret », Le Figaro Magazine, semaine du 23 février 2018, page 100.
- « Nicolas ROUMIANTZOFF », sur Musée de l'Ordre de la Libération (consulté le )
Bibliographie
- Nicolas Pierre Roumiantzoff, « Le Roum », le spahi du général de Gaulle, Le Cherche Midi, 2018, 256 p.
- Nicolas Ross, Entre Hitler et Staline. Russes blancs et Soviétiques en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, éditions des Syrtes, 2021.
Voir aussi
Sources et bibliographie
- Képi blanc et Division histoire et patrimoine de la Légion étrangère
Lien externe
- Portail de l’Armée française
- Portail de la Seconde Guerre mondiale