François Flahault
François Flahault[1], né en 1943, est un philosophe et anthropologue français qui travaille au Centre de recherches sur les arts et le langage comme directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique.
Pour les articles homonymes, voir Flahaut.
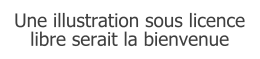
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Formation | |
| Activités |
| Dir. de thèse | |
|---|---|
| Site web | |
| Distinction |
Œuvre
Les recherches philosophiques de François Flahault se fondent sur les nouvelles connaissances en sciences humaines qu'il s'efforce d'articuler dans la perspective d’une anthropologie générale. Il part d'un certain nombre de présupposés de la pensée occidentale concernant l'homme et la société. Il montre ensuite en quoi certains de ces présupposés se révèlent inadéquats à notre époque. Il suggère enfin des représentations plus appropriées qui pourraient se substituer à ces présupposés. François Flahault tient compte aussi des cultures extra-européennes et des possibilités qu’elles offrent de penser autrement. C'est à travers l'interprétation des contes dans différentes cultures que François Flahault perçoit les valeurs qui sont communes aux êtres humains. Cette approche philosophique de l'anthropologie générale est écrite dans un style narratif facilement accessible.
Dans son livre Le Sentiment d'exister. Ce soi qui ne va pas de soi François Flahault poursuit ses recherches antérieures en interrogeant les partis pris sur lesquels se fonde notre tradition de penser et nous entraîne dans une cure de désidéalisation. Être conscient de soi-même ne garantit aucunement qu’on se sente vivre. Par de patients allers et retours entre observations concrètes, connaissances et réflexion, l’auteur montre comment des pistes s’ouvrent, se recoupent ou convergent. Cet ouvrage est aussi une introduction à d'autres livres qui développent plus en détail les nombreux thèmes abordés.
La société précède l'individu. Ce n'était pas évident en Occident
Selon François Flahault, la pensée occidentale, qui se croit progressiste, se fonde depuis des siècles sur la conviction que l'individu précède la société. François Flahault montre que les connaissances humaines actuelles convergent vers la conclusion inverse. La vie sociale précède l'émergence de l'individu dans le processus d'humanisation.
Dans Le Paradoxe de Robinson. Capitalisme et société Robinson Crusoé est décrit comme l'archétype de l'individu autonome vivant en dehors de la société. Sa raison d'être s'établit en relation aux choses et non en relation aux autres êtres humains. Pour Jean-Jacques Rousseau c'était le modèle de l'individu authentique. Karl Marx de son côté, dès les premières pages de son livre Le Capital, se démarque des économistes libéraux qui l'ont précédé. Mais il désire que son livre soit reconnu comme ouvrage d'économie. Marx partage ainsi avec la pensée libérale certains présupposés fondamentaux qui continuent d'imprégner notre modernité.
La société humaine s'organise pour subvenir à ses besoins, répondant ainsi à certaines fonctions pratiques. Le développement de ce motif aboutit à considérer que les êtres humains sont déjà humains avant qu'ils ne vivent en société. Le christianisme, avec Philon d'Alexandrie, nous montre Adam et Ève déjà pleinement humains dans un état pré-social. Les philosophes cartésiens, par le seul fait du "Je pense", ce sentiment d'être soi par soi, croyaient que Dieu en créant l'homme à son image lui avait transmis son pouvoir de penser tout seul.
Cette conviction est remise en cause par des sociologues au XIXe siècle qui réagissent aux effets atomisant de l'individualisme. Le contexte sociologique de l'époque est lié à l'effondrement d'un ordre théocratique millénaire et à la désintégration sociale provoquée par la révolution industrielle. Ces sociologues découvrent que la société est beaucoup plus complexe que si elle était fondée simplement sur la base d'un contrat et d'une constitution politique. Mais ils ne renonçaient pas, comme Marx, à une conception prométhéenne de l'action humaine et dans la foi du progrès.
Les raisons de limiter l'expansion du capitalisme[2] se fondent sur le fait que la vie en société n'est pas seulement un moyen à travers lequel l'être humain cherche à satisfaire ses besoins individuels, mais qu'elle constitue une fin en soi.
- Le contrat n'est pas seul à fournir une garantie.
- La circulation de biens présuppose le don entre générations.
- Le salaire n'est qu'une part des biens en échange du travail.
- La valeur d'un bien marchand ne se réalise qu'en s'articulant avec des biens non marchands.
- Le besoin d'un bien passe par la nécessité et le désir d'exister avec et par rapport aux autres.
- Pourquoi échanger quand on peut prendre ?
- L'être humain ne se limite pas à lui-même.
Être soi-même implique l'interdépendance avec les autres.
Dans "Be yourself!" Au-delà de la conception occidentale de l'individu François Flahault montre comment le mot d'ordre émancipateur 'Sois toi-même', au-delà du désir profond et légitime de réalisation de soi, repose en fait sur la vieille conception de l'individu comme substance, comme noyau inné.
Platon, en rupture avec ses contemporains grecs et avec d'autres cultures, a imposé durablement l'idée géniale qu'il existe en nous un élément supérieur d'origine céleste et non pas terrestre comme l'est notre corps. L'âme (psukhê), n'étant pas de même nature que le corps, a cependant une substance qui fait partie intégrante de notre personne même.
Les neurologues, nos contemporains, ont tendance aussi à concevoir l'esprit, sur le modèle du corps (alors qu'ils ne séparent plus l'esprit du corps), comme une unité fonctionnelle compacte et délimitée, bien distincte de son environnement. Ils accordent beaucoup d'importance au réseau de neurones et pas suffisamment à celui qui relie entre eux les cerveaux des individus partageant la même vie sociale.
Ainsi « l'individu occidental vivra dans un monde et pensera dans un autre ». Il naît d'une femme, il est élevé par ses parents, il s'inscrit dans une lignée, il prend place dans une société, il est nourri par une culture, mais ce ne sont là que des traits contingents, selon la philosophie occidentale.
François Flahault a fréquenté les contes durant une bonne partie de sa vie, afin de s'initier à une forme de pensée étrangère à la logique du concept, mais en les regardant comme une autre culture. Pourquoi ne pas accorder au vaste répertoire de ces récits, qui circulaient avant que l'écriture ne puisse les recueillir, toute leur valeur, comme Lévi-Strauss prenait au sérieux la vision de la condition humaine dans les mythes ?
Dans le conte Le Vilain Petit Canard, Hans Christian Andersen s'est inspiré de la culture écrite du mouvement romantique. Il s'agit d'une histoire de transfiguration, de révélation de l'éclatante valeur du personnage, qui n'est pas un vilain canard mais un cygne. C'est un conte qui ressemble à ceux de la tradition orale, mais ici la métamorphose se produit grâce au personnage lui-même et non pas à des liens qu'il aurait avec d'autres, comme dans les contes populaires d'interdépendance.
Par contre dans La Petite Sirène Andersen se rapproche du conte La Belle et la Bête où les personnages ne deviendront des êtres humains qu'à la condition de se faire aimer. Mais, contrairement à la Bête et pour l'amour du prince, la Sirène refuse son handicap : elle perd sa langue pour de belles jambes, alors que la Bête a compris que se faire aimer d'amour, c'est trop demander. La Bête cherche seulement à gagner l'affection de la Belle par la conversation la plus agréable possible. La Petite Sirène, incapable de renoncer à l'image absolue d'elle-même, son véritable être-soi, commet l'erreur de placer la séduction au-dessus de la conversation : elle reste muette et ne peut dire au prince que c’est à elle qu’il doit la vie. La Sirène affirme la générosité sacrificielle d'une âme sublime, son être comme être-au-delà-de-la-relation. En renonçant à se faire reconnaître du jeune prince la Sirène sauvegarde sa propre infinitude. La Bête et la Belle, au contraire, cherchent à se réaliser à l'intérieur de la condition humaine. Pour eux, être, c'est être-dans-la-relation, ils trouvent leur véritable être-soi en tirant parti des possibilités que recèle leur interdépendance. Grâce aux liens d'affection, la Belle constate que la Bête et le jeune homme de son rêve ne font qu'un.
À l’occasion du Colloque de Cerisy du 20 au 30 juillet 2009 consacré à « La sérendipité dans les sciences, les arts et la décision[3] » François Flahault est intervenu sur le thème « Tirer parti de l’imprévu ». Il présente à travers la notion de sérendipité un rôle très important dans des intrigues qui témoignent d'une vérité de l'existence humaine qui possède une vaste portée philosophique. Ainsi de nombreux contes sont inspirés par les Voyages et aventures des trois princes de Serendip qui est un conte persan publié en 1557 par un imprimeur vénitien nommé Michele Tramezzine.
Parole intermédiaire
Dans La Parole intermédiaire François Flahault avait déjà effectué l'analyse sémiologique[4] des rapports de place qui s'établissent entre les êtres humains dans leurs relations intersubjectives à l'intérieur d'un «système de places[5] ».
Partant des «règles constitutives» du jeu (le hors-jeu, les points, l'essai, l'envoi, etc.) de John Searle[6], la partie de rugby, comme celle d'échecs n'est rendu possible qu'à partir de ces règles et ne saurait par conséquent être comprise en dehors de celles-ci. Les effets d'une action sont des effets conventionnels, c'est-à-dire supportés par le langage. Si tel «coup» est un acte physique et qu'il vaille tant de points, suscitant l'admiration ou la consternation des spectateurs et des joueurs adverses, il n'est rendu possible qu'à partir de règles constitutives explicites.
Bien qu'artificielles ces règles ont sur les joueurs l'effet contraignant d'une seconde nature. Mais les illocutions[7] explicites («tu seras goal», «il a gagné», etc.) se limite à l'espace d'une partie (de la totalité d'un jeu). Les systèmes de places prédisposés par les règles d'un jeu ne sont pas directement en rapport avec l'identité réelle des joueurs. Ceux-ci peuvent d'ailleurs échanger leurs places d'une partie à l'autre.
« Tandis que la place que les parents assignent inconsciemment à un enfant par rapport à ses frères et sœurs et éventuellement à un membre défunt de la constellation familiale, ou encore les places qu'une formation sociale attribue à ses membres dans le système des rapports de production, sont déterminantes quant à l'identité et au destin mêmes de ceux qui viennent les occuper[8]. »
L'enjeu n'est pas comparable à celui d'une partie de football ou de cartes. Une des sources de plaisir propre au jeu est que les rapports de forces qui s'y nouent sont médiatisés par les conventions (médiation d'instance tierce) qui rendent possibles à la fois le jeu et les rapports de forces. Malheureusement, les rapports sociaux et intersubjectifs réels constituent un «jeu» duquel nul n'est libre de sortir. Dans ce cas les rapports de forces sont empreints d'une violence qui déborde constamment les conventions qui prétendent l'endiguer.
D'un côté les actes de parole tirent leur efficience d'un assujettissement complet des sujets au champ de la parole. De l'autre côté cet assujettissement est loin de se résumer à l'effet d'une convention ou d'un contrat explicités (par une instance tierce[9]) : car «il n'existe pour un sujet aucun lieu extérieur à cette convention, d'où il puisse l'examiner, en formuler les termes et décider d'entrer ou non sous sa loi.»
François Flahault mentionne que le protagoniste d'un dialogue ou d'une discussion, soumis à un critère de reconnaissance et en définissant la place dont il se sent habilité à parler et à être entendu, peut se trouver plus ou moins décalé, par rapport à la place qui lui permettrait effectivement de parler et d'être entendu. La mise en place s'opère alors à faux. Le locuteur se trouve «en porte à faux» par rapport à ceux à qui il s'adresse. Et réciproquement ses destinataires ne l'écoutent pas de cette place qu'il leur a assigné. Car ils estiment que lui ne peut être «dans son assiette[10] » à la place d'où il croit qu'«on» lui demande de parler. Il s'agit là, d'un rapport de places imaginaire.
À l'inverse, au cours d'un séminaire de formation d'adultes Alexandre annonce qu'il va parler de la chasse au sanglier. Pourquoi ce thème, à quel titre va-t-il en parler ? Personne ne le sait. Ses premières paroles ne lèvent pas les incertitudes. Il parle comme un livre, comme une encyclopédie sur la chasse au sanglier. Il est tendu, mal à l'aise ; ses auditeurs aussi. Puis, Alexandre se lève pour montrer au tableau la disposition topographique des chasseurs, et annonce : «Moi, j'étais là». Ainsi, il formule indirectement, pour lui et pour ceux qui l'écoutent, la place d'où il peut effectivement parler et être écouté ; « À vous, qui n'avez sans doute jamais eu l'occasion de participer à une chasse au sanglier, moi qui en ai l'expérience, je puis vous raconter comment ça se passe.» Du coup, il parle plus librement et ses explications suscitent un intérêt nouveau et réel. Cadre moyen d'origine ouvrière, Alexandre ne se sentait pas habilité à prendre la parole, comme ceux dont la parole est cautionnée par les livres. «S'il a repris pied, c'est sur le terrain où, comme on dit, il s'y retrouvait[11]. »
Imaginons que quelqu'un soit tout pour tous ou soit tout pour un autre qui est lui-même tout pour lui. Il aurait réalisé au plus haut point des fantasmes de célébrité ou d'amour passionnel. "Étant tout pour tous, il serait en quelque sorte l'incarnation de tous; dès lors, il se dégagerait de l'assujettissement à l'ordre d'une médiation (il pourrait "tout se permettre"). Étant tout pour un autre qui est tout pour lui, il n'aurait plus besoin d'idéologie, non plus que l'autre."
Ordinairement, les choses se passent autrement. L'identité de chacun est délimitée, et non pas illimitée ou incomparable. « L'idéologie a donc pour fonction aussi bien l'assignation des places (d'où son rôle dans la reproduction des rapports de production) que leur mise en relation avec une complétude qui dépasse la limite de ces places. »
« Dans l'énonciation, un sujet, en produisant sa parole, selon quelque discours que ce soit, demande à ses interlocuteurs de le reconnaître, lui, dans le rapport à la complétude qu'il prétend soutenir[12]. »
Scène de ménage
François Flahault est l'un des rares auteurs qui analyse les relations intersubjectives, qui peuvent avoir lieu dans «La scène de ménage» entre une femme et un homme : des invectives comme des rapports de place.
- « Je suis sain(e), tu es tordu(e) »
- « Tu es lamentable »
- « Tu es un monstre »
- « C'est ça, je suis lamentable »
- « Vois ce que tu fais de moi »
- « Je te hais » (injures et coups)
- « Je peux très bien me passer de toi » ou « Tu m'as même pas fait mal »
- « Arrêtons ça »
- « Le recours »
- « Et pourtant je le savais »
- « Ça te fait jouir, hein ? »
- « Le défaut de la cuirasse[13] »
L'analyse de François Flahault vise à montrer comment chacune des douze figures courantes dans une scène de ménage possède à la fois un coût et un bénéfice psychologiques, voire ontologiques. « D'une manière générale, nous désirons faire mal lorsque nous y voyons une occasion d'augmenter notre sentiment d'exister. » Le sens moral nous arrête parfois, lorsqu'une vilaine action nous exposerait à la déconsidération. Mais lorsqu'on estime que l'autre est à l'origine de notre diminution d'être, la réparation nous paraît légitime.
« … c'est lorsque nous croyons le plus maîtriser la réplique adressée à l'autre que, justement, quelque chose échappe : à travers ce que nous disons perce ce qui nous pousse à le dire, et que nous ignorons nous-même[14]. »
Trop pris par son sujet, le chercheur de scènes de ménage a dû négliger sa compagne qui en a profité pour lui faire des … scènes de ménage.
« Elle a dit « abject ». Oui, je n'éprouve moi aussi que dégoût à l'égard de moi-même.
« Je vais te tuer. » Grotesque. Mais sur le moment c'était comme dans certains mauvais rêves où je me voyais assailli par plus fort que moi et où, pour conjurer une menace absolue, il fallait que je tue.»
Le cauchemar, c'est qu'il n'y parvenait pas et que dans la réalité le cauchemar aurait été autrement noir s'il avait tué.
« Sitôt Laurence partie, j'ai été submergé par une vague de honte, de destruction et d'hébétude. »
Écœuré, François veut en finir avec ces notes de recherche, qu'il vomit.
François songe avec amertume à ses vœux d'adolescent, de ne pas faire comme ses parents, dont il se souvient avec émoi, lorsqu'ils se sont séparés. Chez son père il avait découvert une lettre de sa mère. C'était une énième démarche d'explications dont certains morceaux de phrase lui sont restés comme des fragments de bois retrouvés après un naufrage : « Seize ans de notre vie », des mots comme «empoisonné», «torture», «plus jamais» qui l'ouvraient à des réalités qui le dépassaient, l'écrasaient. « Au lieu de nous défendre l'un de l'autre comme des ennemis. », « J'ai l'impression de m'être fait avoir », « Tu n'es pas assez fort pour admettre tes faiblesses[15]. »
La faute des premiers parents a rendu responsable toute leur descendance
Le christianisme est le seul des trois monothéismes basés sur le Livre de la Genèse à avoir fait de l'histoire d'Adam et Ève la clé de voûte de son anthropologie.
François Flahault veut montrer dans son livre Adam et Ève. La condition humaine comment le récit de cette histoire de la Genèse était destiné à faire assumer le caractère problématique et douloureux de la condition humaine. La lecture chrétienne de ce récit en fait le premier acte d'une histoire universelle centrée sur le Salut, c'est-à-dire sur le désir de dépasser la condition humaine.
- Au début du christianisme, le monothéisme juif, celui de Yahvé le Dieu de Moïse, avait déjà fusionné avec le « Monothéisme philosophique : pour les stoïciens, les différents dieux n'étaient que les noms d'une même puissance divine, un principe unificateur qui sera repris par les néoplatoniciens[16] ». La puissance divine unificatrice de la monarchie impériale, celle du souverain qui transcende les sujets, reflétait déjà la puissance divine du Dieu unique d'Israël placé à l'origine de la création, créateur d'Adam et Eve et de l'humanité.
- Cette fusion culturelle a été possible grâce aux juifs très hellénisés d'Alexandrie qui, ne parlant plus l'hébreu, ont fait traduire la Bible (la Septante) en grec. Mais c'est à Philon et à son traité sur « La Création du monde » que l'on doit l'interprétation de la chute de l'homme, du Paradis dans le monde sensible, provoquée par Ève la tentatrice qui mangea du fruit défendu et en donna à Adam. Le désir sexuel « engendra le plaisir physique, principe des iniquités et des prévarications, par lequel les hommes échangent une vie immortelle et bien-heureuse contre une vie mortelle et misérable[17] »
- C'est ensuite saint Paul (Paul de Tarse), véritable fondateur du christianisme, qui a le premier articulé les deux récits de la Chute et de la Rédemption du Nouveau Testament. Ainsi dans l'Épître aux Romains[18] « Comme par la faute d'un seul ce fut pour tous les hommes la condamnation, de même par l'œuvre de justice d'un seul c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Car tout comme par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constitué comme pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul la multitude sera constituée juste ». Le premier homme, tiré du sol, annonce le second, qui vient du ciel[19]. « De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous reprendront vie dans le Christ[20] ». De même que le Christ répond à Adam, Marie elle aussi, s'oppose à Ève comme la vie à la mort. Les Pères de l'Église en viennent à identifier l'arbre de vie à l'arbre de la croix. Celui-ci s'oppose ainsi radicalement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon l'analyse de François Flahault.
- Mais selon saint Augustin le baptême ne suffit pas à effacer les conséquences du péché originel que chaque être humain porte en lui dès la naissance. Il était intimement convaincu de l'impuissance de la volonté, de la masse des fidèles, à faire face à la force incontrôlable du désir, malgré la foi et la morale héroïque des premiers chrétiens. « L'homme a désobéi à Dieu : au lieu de demeurer unis à leur souverain dans l'obéissance, Adam et Ève ont voulu, par orgueil, se faire le principe de leur existence[21]. La punition a été la conséquence logique du péché : la chair s'est à son tour rebellée contre l'esprit. Thomas d'Aquin citera Augustin [Confessions] et l'approuvera[22]. Dans son état original, l'homme n'avait pas à avoir honte de sa nudité, car « alors la concupiscence ne sollicitait pas les organes malgré la volonté []. Doit-il nous sembler étrange que cet organe [le pénis], dans l'innocence, obéisse à la volonté qui commande impérieusement à tant d'autres organes ? Ne remuons-nous pas, quand nous voulons, la main ou le pied ? » Si Adam avait obéi à l'ordre divin, la transmission de la vie serait elle-même restée entièrement soumise à la volonté et n'aurait entraîné ni honte ni impureté[23] »[24]
Le service que la transgression d'Adam et Ève rend au christianisme n'est donc pas seulement d'innocenter Dieu face aux maux dont souffrent les humains. Car la croyance en un Dieu unique, tout-puissant et bon, était évidemment en contradiction avec l'existence du mal. Leur désobéissance, à condition d'y stigmatiser le désir démesuré d'égaler Dieu, permet également d'ouvrir un autre accès au privilège divin, celui-ci légitime et recommandable. Le désir de dépasser la condition humaine est inhérent à la condition humaine. La prétention d'accéder à l'immortalité est démesurée pour un être humain. En contrepartie, le fait qu'il reconnaisse sa dépendance à un être qui le dépasse, de lui être redevable et d'avoir à lui rendre compte dans l'ordre du monde, une telle attitude combat sa propension à la démesure.
« Puisque le chrétien doit humblement reconnaître en Dieu l'unique source de vie, il lui faut nécessairement dénier cette qualité à l'ordre de la sexualité[25] »
L'une des œuvres majeures de Platon « Le Banquet » est un dialogue constitué de plusieurs discours. Celui tenu par Aristophane est une histoire incroyable d'êtres humains doubles, coupés en deux par Zeus pour les punir de leur orgueil (mythe des androgynes), de sorte que chacun désire trouver sa moitié perdue. Les juifs hellénisés et Philon d'Alexandrie imprégné de la doctrine platonicienne de la Chute plaqua celle-ci sur l'histoire d'Adam et Ève.
François Flahault décrit ainsi l'influence du platonisme sur le récit de la Genèse dont la version païenne est très différente de la lecture chrétienne de la Bible car les racines du récit remontent à la plus haute antiquité, à l'épopée de Gilgamesh[26]
Avec les mythes africains de l'origine de la mort et l'histoire du premier couple humain vu par les Muong du Vietnam François Flahault relie la condition humaine à la nécessité d'assumer une identité délimitée, la sexuation, ce qui implique de renoncer à une illimitation première.
De la perception de l'infinitude au besoin de complétude.
Dans un texte sur la croyance, François Flahault cite une curieuse histoire africaine :
« Un dieu créa les bananiers et les hommes. Puis il demanda au soleil de cueillir les bananes mûres, tout en lui interdisant d'en manger. Le soleil remplit sa tâche et déclara s'être conformé à l'interdiction. « Nous allons vérifier », lui dit le dieu, et il plongea le soleil dans un trou. Le lendemain, le soleil sortit de terre, preuve qu'il n'avait pas menti. Le dieu chargea alors les humains du même travail et leur fit la même recommandation. Ceux-ci aussi lui dirent n'avoir mangé aucun des fruits, mais ils mentaient. Le dieu les mit dans un trou. Ils n'en ressortirent pas[27]. »
Les Africains connaissent toutes sortes de récits sur l'origine de la condition humaine. Comme les Indiens Guaranis, qui chantent "J'existe de manière imparfaite", tous pensent que, fondamentalement, ça ne va pas. Car "ils voient bien qu'ils sont des êtres de chair et de sang comme les autres animaux, mais cela n'empêche pas qu'ils sont conscients d'exister et qu'à cause de cela ils se sentent apparentés à un état de perfection, de complétude, et même d'illimitation. Aucun de ces groupes humains n'a pu s'empêcher d'imaginer des êtres qui, eux, seraient dotés de ce qui leur fait défaut. Aucun ne s'est contenté de « voir les choses comme elles sont »[28]."
« L'infinitude, l'illimitation qui, de manière énigmatique, s'attache à l'étrange expérience de se savoir exister, nous pousse à croire qu'il est dans le monde extérieur certaines réalités qui lui correspondent et l'expriment, mais aussi d'autres qui nous protègent du désarroi et des désirs insatiables que ce vide suscite en nous[29]. »
L'être humain se heurte à des limites et le langage lui permet toujours d'imaginer un au-delà de ces limites. L'étendue virtuelle de son être excède nécessairement les conditions matérielles et sociales dans lesquelles il se réalise. L'Indien absorbé par la confection matérielle d'une parure de plumes ne pense pas moins qu'elle lui permettra de participer à un monde idéal dans lequel son existence serait parfaite.
Certaines représentations mentales des humains, ses idées, procèdent du même principe de réalité que ses réalisations matérielles. D'autres répondent à la nécessité de soutenir leur être. Les idées qu'ils se font, sur eux-mêmes et sur leur environnement social et naturel, constituent une manière d'aménager le monde, pour en faire un « chez-soi[30] » qui soutienne l'existence psychique. Pour cela il faut que les humains partagent leur existence avec certains autres, ceux avec qui ils sont liés, ceux avec qui ils forment société.
Les humains sont donc conduits à s'inscrire dans des formes de coexistence et accepter de limiter leur désir insatiable pour un désir complémentaire. Ils ont un fond d'illimitation mais aussi à l'inverse une propension à la délimitation. Liée à l'apprentissage de la propreté exigée dès l'enfance par leurs parents. Le partage entre soi et l'excrément concrétise le partage entre l'être et le non-être - l'être se définissant alors comme le différencié, le délimité, le nommé, le construit, par opposition à l'illimité, à l'innommable, à la confusion, au détruit, au décomposé, au chaos.
L'être humain porte en lui, aussi, le désir à la fois de transgresser et de respecter d'autres délimitations comme la distinction entre morts et vivants, la différence des générations et la différence des sexes. "Les mythes, les contes, le cinéma, les récits de fiction en général jouent sur les tensions dynamiques entre ces deux désirs[31]." C'est pourquoi ils ne cessent de nous renvoyer à l'ambivalence des désirs que nous nourrissons à l'égard des autres : être reconnu d'eux, être heureux avec eux, les aimer, mais aussi leur échapper, les dominer, les tuer[32]."
De la peur et de la soumission à la volonté de toute-puissance.
Les archéologues ont retrouvé sur des tablettes d'argile de la fin du IIe millénaire av. J.-C. et du début du Ier millénaire av. J.-C. des textes mésopotamiens en cunéiforme rapportant les lamentations d'un homme qui se posait la question suivante :
« Quelle faute ai-je bien pu commettre pour me trouver ainsi en butte à la maladie, au chagrin et à la misère[33] ? »
François Flahault, dans son livre "La méchanceté", tente de clarifier la distinction entre les deux questions ; l'origine extérieure du problème du mal et l'amorce intérieure du problème de la méchanceté.
Tout au début, les Mésopotamiens donnaient pour explication à l'origine du mal les attaques de démons maléfiques. Ensuite, ce sont les fautes du plaignant qui apportent la réponse : il avait mal agi, il avait offensé un dieu sans le savoir, il lui fallait donc attendre que le courroux du dieu s'apaise et les choses finiraient par s'arranger. Mais, au début du Ier millénaire, le plaignant ne se limite plus à son propre cas, il étend sa question à l'ensemble des hommes et stigmatise l'injustice sociale.
Dans le Livre de Job, le fossé entre le problème posé et la réponse se creuse encore davantage, car nous savons d'emblée que Job n'a rien fait pour offenser Yahvé : il est véritablement innocent. De surcroît, Yahvé, non seulement ne répond pas au 'Pourquoi ?' de Job, mais en plus le fait taire ; en affirmant ainsi sa toute-puissance.
De l'enfance de ses douze ans François Flahault a gardé un souvenir épouvantable et inavouable de ses descentes à la cave à charbon, les soirs d'hiver. Courbé sur le tas d'anthracite, dans cette cave froide, couverte de suie et faiblement éclairée, où chaque pelletée de boulets produisait sur la tôle du seau un fracas de fin du monde, il sentait subitement derrière son dos la présence menaçante et envahissante d'une stature géante aux mains d'étrangleur qui avançait inexorablement...
- C'était la créature de Frankenstein[34] !
Adulte, François Flahault, a lu et relu le livre de Frankenstein dont il avait vu le film à douze ans avec son frère, pour comprendre la fascination qu'il avait encore pour ce conte violent. Derrière la terreur il y avait bien deux autres sentiments : désir et culpabilité. Dans la douce chaleur de la salle à manger, l'enfant existait au milieu de sa famille. Existence relationnelle de la vie sociale, comportant des limitations complexes, contraignantes et inévitables. À la cave, une forme d'existence illimitée s'ouvrait à lui. Il en éprouvait toute l'intensité dès l'approche de celle-ci : « ...l'infinitude m'absorbait et me confrontait donc à l'imminence de mon propre anéantissement. »
Le cinéma porte l'intérêt surtout sur le monstre. Le roman est plutôt centré sur le couple infernal du créateur et de sa créature. Victor Frankenstein illustrerait le thème de l'apprenti sorcier, du savant emporté par les pouvoirs de la science qui fait retomber sur lui et les autres les conséquences désastreuses de sa démesure. Ce résumé de l'intrigue laisse passer le poison spécifique de l'histoire. « La vie et la mort, raconte le jeune savant, me semblaient des limites idéales qu'il me faudrait franchir ». Au bout du compte, pense-t-il, « une espèce nouvelle me bénirait comme son créateur ». Au désir de transgresser la limite qui sépare les vivants des morts s'associe implicitement un défi lancé à la différence des sexes. Ce qui intéresse Victor, ce n'est pas de faire un enfant à Elisabeth sa fiancée ; c'est de le faire tout seul !
« Victor et le monstre vont s'affronter dans une scène de ménage grandiose, et le décor de celle-ci est à la mesure de leurs passions[35]. » La créature, sans nom, mène une vie solitaire et demande à Victor de lui créer une compagne, en le considérant comme Adam et non comme Satan, l'ange déchu à jamais réprouvé. Mais Victor ne peut pas accéder à pareille demande, ce serait s'enfoncer encore plus profondément dans une transgression destructrice, dont le fardeau lui est déjà intolérable. Après s'être mis à l'ouvrage, Victor détruit son ébauche et jette à la mer les macabres restes, s'exposant ainsi à une vengeance sans fin de la part du monstre. Victor est pris au piège de sa propre illimitation ; il est enchaîné par un lien qu'il ne peut ni briser ni aménager ; il est écrasé par une dette dont il ne peut se débarrasser ni s'acquitter. Ses réactions seront donc des réactions d'impuissance.
- Le tyran est méchant parce qu'il ne voit pas de limites à sa puissance. L'impuissant est méchant par révolte contre son impuissance.
Le monstre commence par étrangler le jeune frère de Victor et fait condamner une innocente à sa place. Après avoir tué tous les proches de Victor le monstre finit par étrangler sa jeune épouse le soir même de leurs noces. Ainsi le monstre se fait le maître de son maître. C'est dans la poussée de son mauvais infini que le monstre trouve son accomplissement.
« Une femme que son amant trompe, enchaînée par la douleur d'une dépendance qui l'arrache à elle-même, se libère en se donnant la mort[36]. Conduisant ainsi à son terme la rage et l'anéantissement qui l'étreignent, elle acquiert l'immense pouvoir de hanter l'infidèle et d'occuper à jamais son cœur. On retrouve ici, dans la réalité et non plus dans la fiction de contes à faire peur, le renversement de l'impuissance en la toute-puissance du spectre[37]. »
« Puisque je ne parviens pas à me rendre aimable, puisque personne n'a pitié de moi, semble dire le monstre, autant me rendre tout à fait détestable et, ainsi, jouir de la terreur et des souffrances que je répands[38]. » L'auteur du roman semble délivrer un message moral : plongé dans la détresse par sa disgrâce physique et son rejet par les autres, le monstre est une victime, et il mérite de la part du lecteur la pitié que Victor son créateur lui refuse.
Le « triangle des relations morales[39] » inscrit les relations interpersonnelles dans un cadre qui scelle une alliance entre la sensibilité, expansion de soi en résonance à une réalité extérieure, et le principe moral d'égalité et de justice de traiter tout être humain comme un alter ego.
Sur la scène moralisatrice, deux personnages : le méchant et la victime innocente, l'oppresseur et l'opprimé. Le spectateur, troisième sommet du triangle, s'indigne du comportement du méchant qu'il diabolise et éprouve de la compassion pour la victime qu'il idéalise. Il s'identifie à la victime et croit n'avoir rien de commun avec le méchant. Le tiers se délivre ainsi de l'ambivalence des sentiments qui se déploient entre les deux pôles. Ce dualisme lui permet de jouir du sentiment exaltant d'être à la fois indivisé et bon !
Mais, François Flahaut souligne à plusieurs occasions que le triangle des relations[40] morales est non seulement complaisant mais aussi dangereux car il confond le principe de la morale avec l'ambivalence qui est constitutive de notre être réel. Ambivalence qui est « la rançon du monothéisme[41] » !
Mort de Prométhée et cure de désidéalisation.
Ce qui nous différencie des autres animaux, c'est que nous sommes capables d'imaginer l'illimité et de nous imaginer dotés d'une existence absolue. La réalité terrestre étant toute autre, nous sommes ainsi en proie à une douloureuse discordance. Ne pouvant la supprimer nous pouvons au moins tenter de l'expliquer.
Prométhée l'un des Titans chargé de répartir les morceaux d'un bœuf lors d'un repas pris en commun, trompe Zeus au profit des hommes.
« De plus, il lui dérobe le feu pour le donner aux hommes. Les défis provocateurs de Prométhée attirent sur lui le châtiment de Zeus[42]. Le souverain des dieux envoie aux hommes la première femme, Pandora. Avec Pandora, divine par sa beauté et son éclat corporels, viennent la sexualité, la reproduction, la mort, les maladies et la nécessité du travail. En donnant le feu aux hommes, Prométhée - qualifié par Eschyle de « philanthrope » - leur apporte aussi la parole, les techniques et les arts : tout ce qui, en élevant les humains au-dessus des autres animaux, les rapproche du divin[43]. »
Cela signifie que c'est Prométhée qui a donné aux hommes des pouvoirs qu'ils sont tentés d'exercer dans la démesure (l'hubris); alors que Zeus avait donné aux humains le sens de la justice (diké), de la retenue (aidos), du respect.
Avec les romans techno-scientifiques de Jules Verne, François Flahault montre très bien ce que le prométhéisme a de sublime[44]. Edmund Burke et la critique de Kant ont donné au sublime une interprétation que Jules Verne n'était pas censé connaître en profondeur mais il en donnait une dimension romantique et pseudo-scientifique qui caractérisait l'idéologie industrielle occidentale depuis le XIXe siècle.
Les romans qui racontent « Les Aventures du capitaine Hatteras » sur un volcan en éruption en mer polaire ou celles du capitaine Nemo des « Vingt mille lieues sous les mers » constituent l'expression la plus achevée de l'imaginaire prométhéen qui a accompagné l'essor des sciences, des techniques, de l'industrie et de l'impérialisme occidental.
Les héros de Jules Verne ne sont pas aux prises avec la société, comme ceux de Balzac, ni comme ceux d'Alexandre Dumas, acteurs de l'Histoire; ils sont aux prises avec la nature, avec l'étendue de la planète. Ils se confortent à la nature, ils établissent avec la planète un rapport spéculaire[45], ils recherchent en elle l'image et l'épreuve de leur propre accomplissement.
François Flahault rappelle comment les histoires d'explorateurs lues dans le journal de Spirou entraient en résonance avec un monde d'images censé correspondre à la réalité. Comme la plupart des garçons de sa génération, il était disposé à partager le désir par lequel Hatteras était possédé à projeter sur le pôle Nord le fantasme d'un lieu de complétude. Mais, après « le havre maternel devenu géographique[46] » François devait éprouver par la suite le désir pour les filles de son âge. L'ardente curiosité pour le corps et le sexe des filles allait rompre le point suprême de l'invite à rêver de Jules Verne, qui permet d'imaginer la virilité jointe à la complétude.
« Hatteras incarne l'entièreté virile. À la différence de la masculinité, c'est en occupant toute la place, donc en tenant les femmes à l'écart, que s'affirme la virilité. Il y a, comme on sait, très peu de personnages féminins dans l'œuvre de JulesVerne[47]. »
Mais c'est avec Ayn Rand, de son vrai nom Alice Rosenbaum, que François Flahault dépeint le mieux le prométhéisme de notre époque d'extrême libéralisme : l'objectivisme[48].
Avec le roman La Source vive (1943 - The Fountainhead) Ayn Rand a connu un immense succès mondial. Elle a ensuite écrit elle-même le scénario du film qui a été porté à l'écran par le cinéaste King Vidor en 1945 : Le Rebelle- 1949.
Howard Roark est un jeune architecte génial et intransigeant, idéaliste et individualiste, en butte à l'incompréhension et au conformisme. À la fin du roman il comparaît devant un tribunal pour avoir dynamité un ensemble de constructions à peine achevées parce que son œuvre avait été dénaturée et abâtardie par des modifications qui étaient censées s'adapter au goût du public. Howard Roark assure lui-même sa défense selon un plaidoyer basé sur les pionniers et les précurseurs qui s'élancèrent sur des voies nouvelles guidés uniquement par leur vision intérieure. Comme Prométhée enchaîné sur un rocher et dépecé par les vautours, il se dresse solitaire contre les hommes de son temps, tout en assumant la condamnation à souffrir comme Adam, parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance[49].
« Roark recycle des lieux communs du romantisme européen en les américanisant. Comme toute figure prométhéenne, il est un individu autofondé : on ne lui connaît pas de parents, il n'a pas d'enfant, il ne dépend de personne et, ce qu'il devient, il le tire de lui-même[50]. »
Le titre du roman La Source vive, désigne la force créatrice qui prend naissance au cœur de l'individu, source inépuisable comme celles qui alimentent le Nautilus et le moteur conçu par John Galt dans un autre roman de Ayn Rand La Grève (Atlas Shrugged, 1957).
Il s'agit d'une saga où se mêlent grands entrepreneurs américains, enquête et utopie. Des individus d'exception disparaissent les uns après les autres … et la civilisation américaine s'effondre. L'enquête tourne autour d'un ingénieur, John Galt, qui a aussi disparu en laissant derrière lui une invention révolutionnaire inachevée. On apprend que John Galt s'est volontairement retiré de la société américaine car il considère que les membres improductifs de la société y sucent le sang des individus créatifs et productifs. Pouvoir abusif qui est, en plus, relayé par l'État. John Galt conduit de fait une grève d'esprits supérieurs, la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis.
« John Galt et ses compagnons fondent la cité de Galt-Gulch dans une région isolée et montagneuse des États-Unis où ces economic outlaws peuvent exprimer en toute liberté leurs capacités de créer, d'inventer et d'entreprendre[51]. »
La cure de désidéalisation[52], pour faire redescendre la philosophie occidentale du ciel sur la terre, conduit François Flahault à exposer quatre erreurs fondamentales du prométhéisme :
- Faire comme si l'être humain ne faisait pas partie de la nature.
- Discourir sur la rationalité en méconnaissant la propension humaine à l'illimitation.
- Dénier l'interdépendance humaine en nourrissant la conviction que l'individu est indépendant de la vie sociale.
- Croire à la possibilité de parvenir à une affirmation de soi inconditionnelle et absolue.
Biens communs vécus
Dans une série d'émissions diffusées aux États-Unis en 1980 l'économiste Milton Friedman et sa femme Rose plaidèrent brillamment en faveur du laissez-faire : Free to Choose.
Le message propagé de l'économie n'étant pas un pouvoir est d'autant plus efficace qu'il reste implicite. Contrairement aux pouvoirs politiques ou syndicaux, l'économie, à condition qu'elle soit libre, n'est pas un pouvoir qui appelle un contre-pouvoir. L'économie libre se traduit par la libre coopération des individus, du moment où chaque individu poursuit son intérêt, en fonction des prix du marché qui résultent de l'offre et de la demande[53].
Selon Friedman, l'économie libre est un bien commun, comme le langage, qui a permis à nos lointains ancêtres de s'échanger librement des signes, avec toute sa richesse et sa complexité. Mais il évite de rappeler l'usage que les humains peuvent faire du langage, ce bien commun, pour servir des intérêts particuliers qui impliquent des rapports de force.
Les discours des experts ou d'autres autorités exercent un pouvoir d'autant plus grand qu'ils correspondent à des représentations partagées par un plus grand nombre de personnes. C'est ainsi que Friedman combat le discours marxiste, mais aussi tout discours qui ne souscrit pas au principe du laissez-faire[54].
L'utopie d'un « libre marché » harmonieux où la combinaison des intérêts particuliers aboutissent toujours et nécessairement au bien commun fait oublier que les traites négrières et le commerce triangulaire étaient considérés, pendant des siècles, « comme une contribution normale et légitime à la prospérité des sociétés qui le pratiquaient [l'esclavage][55]. » En comparaison, la crise des subprimes paraît bénigne. Elle implique pourtant le même rapport de force dans les relations économiques : la place dévolue à l'autre oscille entre celle de fin et celle de moyen.
« L'acteur économique traite l'autre en partenaire d'un échange équitable lorsqu'il a intérêt à le faire ou parce qu'il y est contraint. Sinon, un rapport de force inégal se traduit par un échange inégal, voire par la prédation. Prendre de force a joué un rôle important dans l'histoire économique des sociétés humaines[56]. »
Montesquieu était déjà bien conscient que l'être humain est porté à la démesure. « C'est une expérience éternelle, écrit-il, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites[57] » Montesquieu n'a nullement confiance dans la rationalité supposée des acteurs : dès lors que l'abus est possible, il se produit. Une force ne se limite que si elle y est contrainte par une autre force. Une force n'est donc fondée à en limiter une autre que si elle le fait en vue du bien commun.
« Le déni prométhéen de l'interdépendance se manifeste sur deux plans : cognitif et existentiel[58]. »
L'illusion cognitive consiste à croire que la pensée de l'individu d'exception tire sa seule puissance de pensée des capacités d'invention et de création dont il fait preuve ; la pensée serait un produit sui généris du cerveau, c'est-à-dire de son propre genre, qui lui appartient en propre. Or le cerveau fait partie du corps et les activités cognitives ne sont pas indépendantes des émotions, des affects et des manières d'être incorporées par chaque individu, comme l'a bien montré Antonio Damasio[59]. Nos manières de penser sont comme enchâssées dans nos manières d'être, qui s'élaborent en réaction à celles des personnes auxquelles nous nous trouvons liés, à commencer par nos parents, qui nous laissent ainsi leurs empreintes par transmission, par mimétisme ou par réaction.
Il ne nous est pas possible de nous créer par nous-mêmes puisqu'il faudrait pour cela que nous pré-existions à nous-mêmes[60].
C'est pourtant ce que Pic de la Mirandole a clairement formulé, par le fait que l'âme permettait à l'homme (contrairement à l'animal) de se faire lui-même : « notre condition nous permet d'être ce que nous voulons[61] ». Parallèlement à l'enseignement sur l'immortalité de l'âme par le christianisme, la Renaissance avait commencé à promouvoir une nouvelle conception de l'âme, de nature à séculariser la visée de Salut.
Près de cinq siècles après, Jean-Paul Sartre donnera de la liberté une définition fondée aussi sur une conception prométhéenne de l'être humain : « La liberté, c'est précisément le néant (…) qui contraint la réalité humaine à se faire au lieu d'être[62]. »
Les biens communs, des économistes et des juristes, auxquels on ajouterait le langage et les cultures des anthropologues, sont déterminés au moins par deux critères :
- non-rivalité : la quantité de bien disponible n'est pas diminuée par le fait que d'autres en bénéficient.
- non-exclusion : l'accès à un tel bien est libre.
Au sein de ce vaste ensemble (de biens collectifs ou biens publics selon certains auteurs[63]) François Flahault propose de cerner une catégorie spécifique, les biens communs vécus. Outre les critères de non-rivalité et de non-exclusion, ceux-ci répondent à deux critères supplémentaires :
- primo : pour que de tels biens se produisent, il faut que l'on soit plusieurs à en jouir.
- secundo : étant vécus, ils se traduisent par un affect, un sentiment ; ce sont donc des biens immatériels.
Ces deux critères peuvent être illustrés par le bien-être procuré par une conversation, avec la simple présence d'autres personnes qu'elles soient proches ou inconnues. Le plaisir de lire ou de regarder une émission de télévision n'implique pas toujours la présence des autres (auteurs, lecteurs, téléspectateurs, …) mais n'en constitue pas moins un bien qui relie à eux. Les biens communs vécus ont donc un versant matériel et un versant immatériel. « Du fait qu'un bien commun vécu associe ces deux versants, il est en même temps un bien personnel. Il constitue le vécu de chacune des personnes qui y participent. »
Bien que les biens communs vécus relèvent de l'expérience, ils se révèlent difficiles à objectiver. Nous sommes portés à les idéaliser plutôt qu'à les penser tels qu'ils sont ; à les regarder comme des valeurs, en tenant un discours édifiant, au lieu de les examiner comme des faits.
« Lorsque ce genre de bien attire l'attention d'un philosophe, il fait généralement l'objet d'une approche morale ; il s'agit alors moins de décrire que de prescrire. On se focalise moins sur la connaissance du phénomène en lui-même que sur l'idéal moral qu'il donne l'occasion de rappeler, voire d'exalter. On tend ainsi à surestimer le rôle joué par les intentions des personnes concernées, et à sous-estimer la logique propre des interactions ainsi que les conditions matérielles, sociales et culturelles requises pour la production de ce type de biens[64]. »
À l'origine des droits individuels
Dans son essai Où est passé le bien commun ? François Flahault s'interroge sur le fondement des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme de 1948 constitue le point de départ de son enquête qui le conduit au bien commun[65].
Une telle recherche est justifiée car la notion de bien commun peut être mise en cause[66]:
- Parce qu'elle ne serait plus adaptée aux démocraties laïques. Dans la pensée politique de Thomas d'Aquin (fin du XIIIe siècle), le bien commun occupe une place essentielle. Il affirme à la suite d'Aristote que l'être humain est destiné par nature à vivre en société. Dans la vision théocratique, la vie biologique, sociale et spirituelle prend sa source en Dieu. À la fin du Moyen Âge les légistes des princes et des rois revendiquent contre les pouvoirs administratifs de l'Église une nouvelle souveraineté. Ce mouvement fut accéléré par la Réforme et les guerres de religion, qui brisèrent l'unité de la chrétienté. Les élites intellectuelles de l'Europe (franciscains puis protestants) en vinrent progressivement à considérer que la société n'avait pas été originellement voulue par Dieu. Dieu a créé le monde, les hommes ont créé la société.
Le philosophe John Locke (1632-1704) fut un des grands champions de cette vision. Désormais l'être humain, en brisant la chaîne paternelle et théocratique, n'accomplira plus son existence sociale en participant à un bien commun qui le dépasse, mais en poursuivant son intérêt. Un intérêt bien compris qui s'harmonise avec celui des autres. Deux nouvelles formes d'accord se substituent à la régulation socio-cosmique de la religion. L'une est le fruit des volontés, c'est le contrat social originel, mythe fondateur de la nouvelle conception de l'organisation politique. L'autre qui apparaît au XVIIIe siècle avec les physiocrates résulte des lois naturelles de l'économie, providence laïcisée. - Les régimes totalitaires se justifiaient par la poursuite d'un bien suprême et collectif. Réagissant contre les démocraties libérales censées conduire à une atomisation de la société, le nazisme cultivait l'idéal d'une communauté organique fondée sur la supériorité raciale du peuple allemand[67].L'idéal communiste était de nature à susciter une adhésion plus large : il reconnaissait l'égale valeur de tout être humain, y compris les femmes et les peuples colonisés. Il prônait l'émancipation des opprimés et invitait chacun à contribuer à la réalisation d'une société meilleure. Dans les régimes communistes, le pouvoir n'était pas au service du bien commun. Il s'en servait, au contraire, pour se justifier, se renforcer et s'imposer sans limites.
Cette perversion s'annonçait déjà dans certaines déclarations de Louis Antoine Léon de Saint-Just : Par nature les hommes sont bons et la société harmonieuse. La société idéale est donc à portée de main. « Le législateur commande à l'avenir ; il ne lui sert de rien d'être faible […]; c'est à lui de rendre les hommes ce qu'il veut qu'ils soient[68].» Ainsi, est-il fondé à renverser, s'il le faut par la force, tout ce qu'il juge lié au despotisme. Arrachons l'ivraie et le bon grain poussera de lui-même ! La démesure du régime communiste des Khmers rouges au Cambodge mena ainsi à l'élimination des recours sur lesquels tout individu doit pouvoir compter, à la destruction de la liberté, de la confiance et de la vie sociale. - Grâce au libre marché, le bien commun se réalise de lui-même. Cette conception politique se fonde sur la foi en l'efficience des marchés et rend la conception politique du bien commun inutile, voire nuisible. Selon Bernard Mandeville (« La Fable des abeilles ») et Adam Smith la fameuse main invisible réalise d'elle-même l'intérêt général. L'autre loi aussi fameuse de l'offre et de la demande ne conduit pas nécessairement à l'optimisation du rapport entre coût et résultat dans tous les domaines. L'optimisation s'effectuant au profit des acteurs du marché les mieux placés, aux dépens du plus grand nombre des autres acteurs.
Les économistes sont donc de plus en plus nombreux à penser que, laissés à eux-mêmes, les marchés (surtout financiers) conduisent à des crises répétées auxquelles il n'est possible de remédier qu'en appelant la puissance publique à l'aide. Sinon, la doctrine du libre marché, dès lors qu'elle est mise en œuvre sans restriction et qu'elle laisse libre cours à l'illimitation du désir d'argent, conduit à une forme de darwinisme social. Que les meilleurs ou les plus forts gagnent, et malheur aux vaincus !
« L'état de nature est un état social. En conséquence, l'opposition traditionnelle entre nature et société n'a plus de sens et la question de l'origine de la société ne se pose plus. » Il faut distinguer entre sociétés naturelles, celles qu'observent les primatologues et les sociétés pourvues d'institutions, celles des sociétés humaines[69]. La culture au sens employé par les anthropologues désigne l'ensemble du patrimoine qui n'est pas transmis par les gènes. Distinguer veut dire qu'il n'y a pas plus d'opposition entre la vie et la matière, la vie étant apparue à partir de la matière, qu'il n'y a pas d'opposition entre nature et culture puisque la culture s'est développée sur la base de la nature. Il se produit une synergie qui a pour effet paradoxal de rendre le biologique tributaire de la culture[70].
« Le développement du langage a permis celui de la conscience de soi, il a fait de nous des personnes. » Le profit qu'il y a à parler n'est pas seulement utilitaire, en se liant aux autres et en suscitant leur intérêt il s'agit de s'intégrer à un cercle existant en formant ou en renforçant son prestige[71].En réalité, on désire se faire reconnaître, s'affilier, entretenir un contact. En bref, exister[72]!« Ce que des singes font en épouillant leurs proches ou en se livrant à d'impressionnantes manifestations de force, nos ancêtres ont appris à le faire aussi en parlant[73]. » « Si, pour exister, il faut avoir une place parmi les autres, cela implique que la place où l'on a lieu d'être est limitée par celle des autres[74]. »
Le sentiment d'exister des individus est donc tributaire des formes sociales et culturelles de coexistence[75]. « Avoir sa place parmi les autres et jouir d'un bien-être relationnel, telle est pour chacun de nous la première forme de bien[76]. » « Le bien commun peut être défini comme l'ensemble de ce qui soutient la coexistence, et par conséquent l'être même des personnes. » Notre condition est ainsi en continuité avec celle des autres primates. Tout chimpanzé se trouve dès sa naissance entouré de ses congénères. L'attachement réciproque qui le lie à sa mère le soutient encore longtemps après qu'il a cessé de se réfugier contre elle et de s'agripper à sa fourrure. « Chez les humains, la place donnée par les parents à leur enfant et le nom propre qui la symbolise l'inscrivent également dans un espace de coexistence. »
Ces premiers liens sont à la source de son sentiment d'exister ainsi que de sa socialisation. L' « atmosphère », l' « ambiance » de ces relations constituent, tout au long de la vie, la toile de fond de l'existence humaine. Et constitue par la même occasion le bien commun vécu qui règne dans un groupe plus ou moins nombreux d'êtres humains. L'économie, à elle seule, ne saurait rendre compte des multiples facteurs qui font le bonheur ou la misère d'un individu, d'un groupe spécifique ou d'une classe sociale. Il faudrait qu'une discipline comme l'écologie sociale s'efforce de comprendre la manière d'être et le comportement des individus en les replaçant dans l'écosystème relationnel qui constitue à proprement parler leur milieu de vie[77].
Les biens communs retiennent moins l'attention que les biens marchands. Ces derniers occupent le devant de la scène sociale, car ils proposent et s'imposent aux désirs, alors que les biens communs se fondent dans le paysage. « Au bal de la consommation, les biens communs font tapisserie. » Le désir d'exister est toujours désir d'exister aux yeux des autres. Le désir d'exister se trouve engagé dans le mimétisme, l'émulation ou la rivalité. Les entreprises l'ont bien compris, qui investissent des sommes colossales dans le marketing. Les choses qui s'achètent, avec leurs effets immédiatement visibles, se présentent comme d'irrésistibles alliés au service de l'existence sociale, du prestige ou du pouvoir. En désirant les mêmes choses que les autres on s'intègre à la société et en achetant un bien prisé on se rend plus riche que les autres, en se démarquant davantage. « Comme Aristote le constatait déjà, le désir est sans limite[78]. »
Les biens communs, se prêtent mal à une évaluation en termes de prix. Il n'est donc pas facile de comparer leur valeur à celle des biens marchands. D'où la croyance, qui contribue à faire oublier la valeur et même l'existence de ce bien commun premier qu'est la coexistence, le fait d'être relié aux autres. C'est la croyance (surtout américaine) que l'individu possède en lui-même la source de son être, de manière innée. Dans la pensée économique, l'Homo economicus est un individu, auquel ne se pose pas la question d'être, mais seulement d'avoir. Cette pensée en revanche a été parfaitement intégrée par le management (y compris dans la culture européenne). L'économie est portée à considérer les biens communs comme des externalités.
Le temps de travail passé sur un lieu de travail par un employé, peut être évalué par son employeur comme le rapport économique entre coût du travail fourni et valeur marchande produite par le travail. Le bien-être ou le mal-être éprouvé par l'employé dans l'environnement de son activité professionnelle ne donne pas lieu, en général, à une évaluation quantifiable par l'employeur qui considère un tel état d'être comme une externalité. « Mais, du point de vue du salarié, son temps de travail est au contraire celui de sa propre vie. Avoir un emploi, c'est avoir une place dans la société, donc avoir lieu d'être, au sens littéral de l'expression[79] ».
Coexistence humaine comme écologie sociale
François Flahault montre à partir de textes comme La Richesse des nations d'Adam Smith[80](1776), « Le Triomphe de la cupidité » de Joseph Stiglitz[81](2010) et d'autres analyses publiées à la suite de la crise financière dont le constat est toujours le même : celui d'une situation contraire au bien commun.
- Une petite minorité de super-riches face à des millions d'humains dans la pauvreté et la misère.
- Un système financier qui a convaincu les États de lui céder une part de leur pouvoir.
- Le déploiement prométhéen de la technique et de l'économie.
- Sous-estimation du rôle que jouent les bien communs et la vie relationnelle dans l'existence humaine, corrélat d'une surévaluation des liens marchands[82].
En avril 1947, un an et demi avant l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Friedrich Hayek fondait la Société du Mont-Pèlerin en compagnie de son maître Ludwig von Mises et de Milton Friedman. La Société entendait promouvoir une doctrine économique opposée au keynésianisme alors dominant : le New Deal était une parenthèse malheureuse qu'il fallait maintenant refermer. L'entreprise fut largement financée par les puissances industrielles et financières. La guerre froide a donné lieu à une polarisation des visions du monde difficile à imaginer aujourd'hui. « Il est difficile aussi d'imaginer à quel point Franklin Delano Roosevelt fut un objet de haine dans les milieux du big business et plus généralement chez les conservateurs. »
Pendant vingt-cinq ans les promoteurs de la « révolution conservatrice» rongèrent leur frein, mais mirent à profit cette période pour étendre et renforcer leur réseau d'influence international.
« Ils étaient partisans des droits humains dans la mesure où ceux-ci défendaient les droits individuels contre les États oppresseurs, en particulier les dissidents soviétiques contre les régimes communiste et le Goulag. Mais les droits économiques et sociaux[83] devaient rester dans l'ombre pour la même raison que l'expression « bien commun » devait être rayée du vocabulaire politique[84]. »
François Flahault revient sur l'expression « science économique » qui apparaît en même temps que celle de « laisser-faire » sous la plume de François Quesnay (1694-1758) et de la « physiocratie » (« gouvernement par la nature ») qui affirment qu'il existe des lois économiques naturelles, aussi scientifiques que les lois de Newton. « C'est là le point de départ de l'essentialisation du capitalisme. [Rappel que la vie intellectuelle européenne du XVIIIe siècle fut traversée par une crise de la foi en la Providence]. En effet, ce n'est pas en s'appuyant sur la finalité supposée des phénomènes de la nature que la science galiléenne s'imposa, mais sur la causalité. Tout l'édifice théologico-scientifique sur lequel reposait la scolastique – l'association du finalisme aristotélicien avec le Dieu chrétien – s'écroulait[85]. »
Si le « véritable capitalisme » prétend réduire le rôle de l'État, beaucoup de gens de gauche, tributaires du discours de leurs adversaires, ont voulu voir dans le renflouement massif des banques par l'argent public la preuve de l'échec du néolibéralisme. Mais, si l'on considère l'histoire des activités économiques en Occident ou dans d'autres cultures, on s'aperçoit que le capitalisme de Marx ou celui de Milton Friedman n'existe pas et n'a jamais existé.
Bruno Amable dans son livre Les Cinq Capitalismes (Le Seuil, 2005) souligne la diversité des formes contemporaines du capitalisme. L'anthropologue Jack Goody depuis son livre L'Orient en Occident (Le Seuil, 1999) montre de manière convaincante que, d'un bout à l'autre de l'Eurasie, dans toutes les sociétés issues de l'âge du bronze où la vie urbaine et l'écriture se sont développées, on trouve des formes de capitalisme marchand. « On peut s'interroger, écrit Jack Goody au terme d'une relecture de Braudel, sur l'utilité du concept de capitalisme[86] »
L'apparition de L'Homo sapiens lors de la période, la plus longue qu'elle fut, durant laquelle celui-ci cueillait et chassait, les ressources redistribuées à l'intérieur du groupe ne provenaient pas de l'échange, mais de la prédation.
« Toujours et partout, le big man, le seigneur, le roi, est un homme qui fait converger vers lui les ressources et en redistribue une partie à ses obligés. »
Si on renonce à essentialiser le capitalisme on redécouvre certains invariants anthropologiques que les marxistes et les chantres du libre marché avaient préféré oublier. Oubli du désir (inquiétant) au profit du besoin (plus rassurant). Oubli de la libido dominandi (désir d'être au-dessus des autres) de la théologie médiévale. Oubli de l'amour-propre (passion jamais satisfaite) des jansénistes. Oubli, enfin, « que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » de Montesquieu.
Il faut donc en revenir à la leçon de Montesquieu : réguler la finance, bien sûr ; réduire son pouvoir afin qu'elle serve l'économie réelle plutôt que de constituer pour celle-ci un coût croissant ; lutter contre la fraude et les paradis fiscaux ; séparer banques de dépôt et banques d'investissement ou instituer d'autres formes de cloisonnement propres à empêcher la diffusion systémique de la défiance ; relever le montant des fonds propres exigés des établissements financiers, etc.[87].
« La politique, comme l'économie selon Necker, est un art de l'équilibre, et il n'est aucune loi de la nature ou de l'histoire sur laquelle on puisse compter pour que se réalise un équilibre favorable au bien commun. Il faut donc en revenir à la leçon de Montesquieu. »
Mais François Flahault suggère aussi de rejoindre l'analyse de Amartya Sen dans L'Idée de justice (Flammarion, 2010) en ce que nous avons quelque chose à apprendre des mouvements qui luttèrent contre l'esclavage. Il relève deux évènements littéraires historiques. À la fin de l'année 1847, Marx âgé de trente ans écrivit avec le concours d'Engels le Manifeste du parti communiste. « On connaît la première phrase du Manifeste : « Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme. » En 1789, dans son Mémoire en faveur des gens de couleur, l'abbé Grégoire avait fait une autre prophétie : « un feu couve dans l'Europe entière, et présage d'une révolution prochaine. […] Il ne manque, ajoute-il, qu'un Othello pour réveiller dans l'âme des nègres le sentiment de leurs inaliénables droits[88]. ».
Cet Othello, en la personne de Toussaint Louverture, la colonie française de Saint-Domingue ne tarda pas à le trouver. La révolution haïtienne ne fut qu'une étape dans le très long processus qui aboutit à l'abolition de la traite et de l'esclavage. « Et l'ensemble de ce processus ne fut pas une révolution[89]. »
La discordance de la vision prophétique de Marx avec les faits, entre le 21 février 1848 de l'édition allemande à Londres du Manifeste du parti communiste et le 27 avril 1848 du Décret d'abolition de l'esclavage à Paris, n'est pas seulement liée au hasard ou aux écarts de dates, mais s'explique sans doute parce que Marx pourtant concerné par l'esclavage comme forme superlative de l'exploitation de l'homme par l'homme ne montra guère d'intérêt pour son abolition.
Dans le Nouveau Monde comme en Angleterre, les quakers furent les premiers à lutter contre l'esclavage. En 1727, ils déclarent la traite inacceptable. En 1761, ils excluent ceux de leurs membres qui s'y livrent. « En 1783, ils forment à Londres un Comité pour l'aide et la libération des esclaves. Ils sont issus de l'effervescence religieuse et politique, que connut l'Angleterre au XVIIe siècle, fondés sur une solidarité des opprimés ». Le sort des marins, par exemple, n'était guère plus enviable que celui des esclaves[90]. « Leur argument essentiel est moral ». En France, la Société des amis des Noirs est fondée en 1789. « Dans un pays marqué par la tradition catholique, avec ses valeurs de hiérarchie et d'obéissance, la révolte de Luther apparaissait comme un épisode fâcheux[91]. »
Dans les conditions actuelles, on voit mal comment un mouvement politique fondé sur une philosophie du bien commun pourrait se développer en Europe. Cependant, nous Européens devons pour commencer mettre en question l'orthodoxie économique dont les États-Unis constituent, en quelque sorte, le Vatican. L'emprise de cette orthodoxie porte avec elle une vision de l'homme et de la société aussi fausse que la vulgate des marxistes. Cette dernière affirmait, que l'esclavage a été progressivement supprimé parce qu'il avait cessé d'être rentable. Il leur fallait résoudre la contradiction entre l'histoire réelle d'un mouvement de libération d'une si grande ampleur, qui s'étendit depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du siècle suivant[92], … et les « lois de l'histoire ».
« L'Union européenne doit aujourd'hui trouver un second souffle. Ce n'est plus le vent du libre marché qui peut le lui apporter.» Les nations occidentales sont les plus riches qui n'aient jamais existé au monde. Cela devrait les inciter à se fixer, dans leur imaginaire de l'avenir, des ambitions d'un autre ordre[93].
« Ceux qui associeraient l'exemple de la révolution luthérienne et des luttes contre l'esclavage avec une pensée politique du bien commun, y trouveraient sans doute un encouragement. »
Publications
- L'Homme, une espèce déboussolée. Anthropologie générale à l'âge de l'écologie, Fayard, 2018.
- Où est passé le bien commun ?, Paris, Mille et une nuits, , 251 p. (ISBN 978-2-7555-0594-8).
- Le crépuscule de Prométhée,, Paris, Mille et une nuits, , 290 p. (ISBN 978-2-7555-0100-1).
- Adam et Ève. La condition humaine, Paris, Mille et une nuits, , 292 p. (ISBN 978-2-7555-0011-0).
- Be Yourself, Au-delà de la conception occidentale de l'individu, Paris, Mille et une nuits, , 270 p. (ISBN 2-84205-931-X).
- (Édition en langue espagnole, ¿Quién eres tú? Identidad y relación, Madrid, Sequitur, 2009).
- Le paradoxe de Robinson. Capitalisme et société, Paris, Mille et une nuits, coll. « Les petits libres n° 59 », , 174 p. (ISBN 2-84205-919-0)
- Pourquoi limiter l'expansion du capitalisme ?, Descartes & Cie, 2003.
- Le Sentiment d’exister. Ce soi qui ne va pas de soi, Paris, Descartes & Cie, , 824 p. (ISBN 2-84446-034-8).
- La Pensée des contes, Anthropos (Economica), , 278 p. (ISBN 978-2-7178-4305-7).
- La méchanceté, Paris, Descartes & Cie, , 219 p. (ISBN 2-910301-91-5).
- Face à face, histoire des visages, Plon, .
- L'interprétation des contes, Paris, Denoël, , 278 p. (ISBN 2-7178-4305-1), nouvelle édition en 2001.
- La scène de ménage, Paris, Denoël, , 177 p. (ISBN 2-207-23370-7).
- Jeu de Babel. Où le lecteur trouvera matière à inventer des fictions par milliers, Paris/Montréal/Paris, Point Hors Ligne, , 267 p. (ISBN 2-89135-008-1).
- La parole intermédiaire, Paris, Le Seuil, , 233 p. (ISBN 2-02-004812-4) - Préface de Roland Barthes - Prix Roland de Jouvenel de l’Académie française en 1978
- L'extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité, Maspero, .
Notes et références
- Bibliographie complète de François Flahault au CRAL
- Le paradoxe de Robinson est une version augmentée de Pourquoi limiter l'expansion du capitalisme ?, Descartes & Cie, 2003.
- « La sérendipité dans les sciences, les arts et la décision »
- Il semblerait que ce livre (indisponible en librairie, fin 2009) fournisse les fondements théoriques des recherches de François Flahault, en particulier sur les notions de «système de places» et de la «complétude» dans l'énonciation sémiologique [annotation de l'utilisateur].
- "La parole intermédiaire" – II. Acte illocutoire et place – B. Des faux modèles aux systèmes de place - page 54.
- dans les Actes de langage (p.93).
- François Flahault explique ce que depuis John Langshaw Austin on entend par verbes performatifs (voir la performativité), ceux dont la signification a «pour référent l'acte même que constitue leur énonciation» : l'énonciation «je te félicite» pour «féliciter» est performatif, alors que «je t'insulte» qui fait référence à l'acte d'insulter ne constitue pas à lui seul (le verbe «insulter») la réalisation de l'acte. Cette propriété particulière à certains verbes a permis à Austin et à Searle (représentants de la philosophie analytique) d'ouvrir la voie à ce qu'ils ont appelé les «actes illocutionnaires» ou mieux «actes illocutoires» (consulter acte de langage). Dans "La parole intermédiaire" – II. Acte illocutoire et place – A. Du performatif à l'illocutoire - page 38.
- "La parole intermédiaire" – II. Acte illocutoire et place – B. Des faux modèles aux systèmes de place – Sur les jeux - page 56.
- Un contrat ne crée pas un rapport entre deux parties prenantes : il règle ce rapport. Le changement du rapport introduit par la règle, c'est que désormais il est limité par une instance tierce. Cela ne supprime pas le rapport de forces, mais modifie seulement leurs conditions d'exercice, soit en tempérant la violence et apportant contre elle des recours, soit en lui fournissant au contraire une couverture. François Flahault dit : «chaque sujet n'existe que s'il est reconnu qu'il existe, et il ne s'attire cette reconnaissance que s'il en produit le signe attendu». Pour produire le signe souhaité le sujet doit convoquer son interlocuteur à une place corrélative à l'intérieur du système de places d'où chacun accède à son identité. Les actes juridiques constituent une espèce de genre «acte illocutoire explicite»; espèce institutionnalisée et dotée d'un appareil ad hoc. Seul l'acte illocutoire explicite engage à la manière d'un contrat. Au contraire, l'acte illocutoire implicite, dépourvu de ce caractère de publicité, ne peut engager le locuteur et pas davantage offrir un recours à l'interlocuteur. Cette absence de recours est particulièrement évidente lorsque l'illocutoire agit sans que le destinataire, voire son auteur lui-même, en soit conscient.
Pour mieux comprendre, consulter l'appellation «double contrainte».("La parole intermédiaire" – II. Acte illocutoire et place – B. Des faux modèles aux systèmes de place – Sur l'acte juridique - page 59). - L'expression doit être prise dans le sens de la navigation Assiette (navigation) selon son sens d'origine assiette
- "La parole intermédiaire" – II. Acte illocutoire et place – Sur la place d'où je crois devoir parler, mais d'où je ne parviens pas à parler - page 67.
- "La parole intermédiaire" – III. Comment le langage colle au réel – C. La complétude et l'idéologie - pages 96-97.
- La Scène de ménage, pages 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135, 139, 143, 144, 146.
- "La scène de ménage", page 64, "... le versant explicite de nos paroles constitue un acte de clarification ou d'assentiment à l'autre, tandis que le versant implicite est porteur de la réaction blessante." (page 63) et ce versant implicite peut rêtre inconscient.
- La Scène de ménage, pages 170-172.
- Adam et Ève. La condition humaine page 29.
- Citation de Philon d'Alexandrie reprise dans Adam et Ève. La condition humaine à la page 32.
- (V, 12 à 21).
- (I Corinthiens, XV,45-46)
- (idem, XV,21).
- La Cité de Dieu livre 14, chapitre 13.
- " Somme théologique, prima pars, secundae, questions 79-89 " question 82, article 3
- "La Cité de Dieu", livre 14, chapitres 17, 23 et 26.
- "Adam et Ève. La condition humaine" page 44.
- "Adam et Ève. La condition humaine" page 59.
- "Adam et Ève. La condition humaine" - "L'épopée de Gilgamesh" (page 112) - François Flahault évoque surtout l'initiation de Enkidu à la civilisation par la relation sexuelle avec une courtisane et la douloureuse condition humaine de Gilgamesh. Mais sur la création des premiers parents il semblerait que ce soit la tablette d'argile sumérienne sur "Enki et Ninhursag", se trouvant au Louvre, qui serait à l'origine de l'histoire d'Adam et Ève. Du moins c'est la thèse que développe le journaliste Pierre Jovanović dans son livre "Le Mensonge Universel" basée sur la traduction de la tablette par un assyriologue le Professeur Pascal Attinger. Selon cette thèse ce serait un scribe juif dénommé "J", ou plusieurs, qui aurait commis un plagiat pour des raisons morales, à connotations sexuelles et misogynes. Les Pères de l'Église Catholique auraient ainsi confirmé les présupposés du Livre de la Genèse comme le montre si bien François Flahault. Mais en fait, Adam et surtout Ève n'aurait jamais commis de "péché originel", car pour les scribes sumériens qui ont écrit "Enki & Ninhursag" l'amour guéri de la mort.
- "Le sentiment d'exister" - Ch.4 « Ça ne va pas, mais quand même ... » p. 84.
- idem p. 87.
- idem p.88.
- François Flahault utilise le terme home, mais l'expression française de chez-soi est aussi explicite.
- Référence à "La Pensée des contes" qui analyse et illustre en détail la manière dont les contes se livrent à ce jeu.
- "Le sentiment d'exister" - Chap. 19 « Entre illimitation et coexistence » p. 372.
- "La méchanceté" – "La rançon du monothéisme" – page 23 - François Flahault fait ici référence à l'article de Jean Bottéro, "Le Problème du mal", dans le Dictionnaire des mythologies, sous la direction de Y.Bonnefoy, Flammarion, 1981, t.II, p. 56-64.
- Mary Shelley a écrit 'Frankenstein ou le Prométhée moderne' à dix-neuf ans et les idées qui bouillonnaient dans son esprit étaient surement liées aux philosophies de son époque : philosophie des Lumières, idéaux révolutionnaires, individualisme romantique, sans oublier le sombre répertoire véhiculé par le roman gothique et le goût du sublime. ("La méchanceté" – "Le spectre de la malfaisance absolue" – page 50.)
- François Flahault fait ici référence à son livre "La scène de ménage",1987, Denoël.
- De kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Tel, Gallimard, 1985, p. 88-94, livre de Maurice Leenhardt, pasteur et ethnologue français qui passa vingt cinq ans parmi les Canaques de Nouvelle-Calédonie.
- "La méchanceté" – "Le couple infernal" – page 91.
- "La méchanceté" – "Pitié pour le monstre" – page 95.
- Répandu dans la seconde moitié du XVIIIe par exemple dans Théorie des sentiments moraux d'Adam Smith ou plus récemment dans La Souffrance à distance. Monde humanitaire, médias et politique de Luc Boltanski, Métallité, 1993.
- Dans L'extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité (1972-voir bibliographie) une étude approfondie est faite (p.43) sur la "triade osirienne" (Osiris-Isis-Horus) dans le cadre de « l’analyse structurale »
- « La méchanceté » – « Pitié pour le monstre » – page 96.
- C'est le sujet de la tragédie d'Eschyle, Prométhée enchaîné.
- Le livre de François Flahault Le Crépuscule de Prométhée. Contribution à une histoire de la démesure humaine page 34, édité en 2008.
- Cette notion apparaît dans le Traité du sublime, attribué à Longin, qui date vraisemblablement du Ier siècle apr. J.-C. Le titre grec Peri upsous signifie littéralement : De l'élévation. Est sublime ce qui «élève l'âme, dit la traduction de Nicolas Boileau, et lui fait concevoir une plus haute opinion d'elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c'était elle qui eût produit les choses qu'elle vient simplement d'entendre ». (Boileau, Œuvres complètes Galimard, Pléiade, 1966, chap.V.).
- Voir 'Réflexion spéculaire'.
- "Le crépuscule de Prométhée" – "Rêveries polaires" – page 128.
- "Le crépuscule de Prométhée" – "Hatteras" – page 140.
Ajoutons, qu'en dehors de La Castafiore, les personnages féminins étaient aussi absents dans les Aventures de Tintin. Il a fallu attendre l'arrivée de Gaston Lagaffe pour que les filles soient un peu mieux représentées sur la BD francophone (Mademoiselle Jeanne). - « Active jusqu'à la fin des années 1970 (elle meurt en 1982), Ayn Rand a exercé une influence considérable sur la vie intellectuelle et politique américaine, notamment dans la haute administration républicaine. Elle a contribué à nourrir le courant qui triompha avec l'élection de Ronald Reagan, l'un de ses disciples les plus fervents, à la présidence du pays. Sa pensée [a connu un regain de faveur jusqu'à l'élection de Barack Obama ...] aux États-Unis ; 800 000 exemplaires de ses ouvrages [se vendaient] chaque année. L'Ayn Rand Institute déclare diffuser la « philosophie objectiviste » d'Ayn Rand en vue de promouvoir le libre marché, l'individu, la liberté et l'exercice de la raison en tant qu'antidotes contre le multiculturalisme, les politiques de l'environnement, les courants de pensée qui accordent une importance exagérée à l'État et autres manifestations d'irrationalité. » ("Le crépuscule de Prométhée" – "Prométhée, version ultralibérale" – page 187).
- idem - "Prométhée, version ultralibérale" - « Le Rebelle » - page 192.)
- idem - "Prométhée, version ultralibérale" - « Le génie romantique, version américaine » - page 200.)
- idem - "Prométhée, version ultralibérale" - « Laissez Faire City » - page 189.
- Dans 'Le Sentiment d’exister. Ce soi qui ne va pas de soi' près de la moitié de l'ouvrage est consacré à 'Une cure de désidéalisation' dans une première partie de 295 pages (p.69 à p. 364) la seconde partie étant intitulée 'Être et vie en société' (p.369 à p.819)
- Friedman (1912-) évoque la fameuse «main invisible» d'Adam Smith (1723-1790) qui permet la régulation des prix, la production et la circulation des marchandises qui s'effectuent selon un processus harmonieux sans aucune planification. Cependant, dans son traité De la monnaie (1751) l'abbé Galiani (1728-1787) parlait déjà d'une « main suprême » et Frédéric Bastiat (1801-1850) continuait à voir dans l'autorégulation du libre marché une loi voulue par la Providence divine. (idem - « Les erreurs du promothéhéisme » - page 244)
- Le discours de Friedman sert les intérêts des managers et des financiers, d'où, par exemple, son opposition à la sécurité sociale. Celle-ci, dit-il dans Free to Choose, se révèle en réalité coûteuse pour les pauvres et profite à d'autres qui sont moins défavorisés qu'eux. Mais il n'est pas aussi paradoxal que Ayn Rand, qui présente les hommes d'affaires comme une minorité persécutée.(idem - « Les erreurs du promothéhéisme » - page 245).
- Le crépuscule de Prométhée – « Les erreurs du promothéhéisme » – Rationalité économique et illimitation - page 248.
- idem - « Les erreurs du promothéhéisme » - page 249.
- Montesquieu, De l'esprit des lois, livre XI, chap.IV, Garnier-Flammarion, 1979, t.1, p.293.
- Le Crépuscule de Prométhée – page 254.
- Dans L'Erreur de Descartes. La raison des émotions (Odile Jacob, 1995) et Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions (Odile Jacob, 2003).
- Le crépuscule de Prométhée – Le prométhéisme comme déni de l'interdépendance humaine - page 256.
- G.Pico della Mirandola, De la dignité de l'homme, Éditions de l'Éclat, Combas, 1993, pp. 9 et 13.
- Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant, Gallimard, 1943, p.654.
- Biens publics mondiaux, par Philippe Golub et Jean-Paul Maréchal, dans le Dictionnaire de l'autre économie, sous la direction de Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani, « Folio », Gallimard, 2006, p.67 .
- Le crépuscule de Prométhée- « Les erreurs du promothéhéisme » – Le concept de bien commun vécu – page 263.
- Référence aux nombreux éléments de la page des droits de l'homme dont la lecture attentive fera comprendre les aspects juridiques de la Magna Carta, de l'ordonnance de l'Habeas Corpus, des Bill of Rights classiques. Il relève les positions de John Peters Humphrey, de René Cassin, de Eleanor Roosevelt et des différents membres de la commission mus, avant tout, par une commune exigence morale dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Où est passé le bien commun ? - Ch II Les sources des droits humains et la question de leur universalité – p.43. Elle relève aussi de la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, de l'Organisation internationale du travail, analysée par le juriste du droit du travail Alain Supiot dans son livre L'Esprit de Philadelphie - idem – Ch IV Une révolution scientifique qui donne accès au fondement des droits humains et du bien commun – p.90.
- Ce résumé provient du - Ch I Le bien commun, une référence dépassée, p.21 - assez court, qui renvoie à un - Annexe 1 - Le bien commun dans l'histoire de la pensée politique, p.203 – qui en donne une version plus étoffée.
- George L. Mosse, Les Racines intellectuelles du Troisième Reich (1964), Le Seuil, coll. « Points », 2008.
- « Discours sur la Constitution de la France prononcé à la Convention nationale dans la séance du 24 avril 1793 », in Saint-Just, On ne peut pas régner innocemment, Mille et une nuits, 1996, p.12.
- François Flahault mentionne les trois disciplines scientifiques qui ont renouvelé complètement les connaissances sur l'être humain : la primatologie, la paléoanthropologie et la psychologie du développement. Il mentionne en particulier le japonais Kinji Imanishi pionnier de la primatologie avec une avancée décisive au cours des années 1950. Mais aussi les observations des décennies suivantes faites par Jane Goodall qui découvre que les singes ont une véritable vie sociale. « Où est passé le bien commun ? » – Ch IV Une révolution scientifique qui donne accès au fondement des droits humains et du bien commun – p.89-92.
- Le développement d'un langage acquis a favorisé celui du cerveau, et réciproquement - « La culture, autre moteur de l'évolution » de Kevin N. Laland et Isabelle Coolen, La Recherche, N°377, juillet-août 2004
- « Éthologie du langage », dans Jean-Louis Dessalles, Pascal Picq, Bernard Victorri, Les origines du langage, le Pommier, 2006.
- Dans La Parole intermédiaire, François Flahault a montré comment la portée explicitement informationnelle de la parole se double d'une portée existentielle le plus souvent implicite.
- - idem - Ch IV Une révolution scientifique ... – p.92-99.
- idem p.103.
- Hannah Arendt dans la Condition de l'homme moderne (1958) – Pocket, coll. « Agora », 2003, début du chap. I – rappelle que le latin employait comme synonyme de « vivre » l'expression « être parmi les hommes » (inter homines esse)
- Voir "Le sentiment d'exister" chap. 22, « La coexistence précède l'existence de soi »
- « Où est passé le bien commun ? » - Ch V – Le bien commun - Le bien premier est la coexistence – p.113-119.
- « D'où le jeu des attractions passionnelles. » comme dirait Charles Fourier, que François Flahault ne cite pas. - idem - Ch V – Biens communs et économie marchande – p.138,139.
- Voir Danièle Linhart, « Perte d'emploi, perte de soi », Érès, 2002, en collaboration avec Barbara Rist et Estelle Durand - Ch V – Biens communs et économie marchande - p.142,143.
- Recherches sur la nature de la richesse des nations, Gallimard, coll. « Idées », 1976, Livr I, chap. VIII, p.90-92. - « Dans son esprit, le rapport entre l'offre et la demande est une chose, le rapport entre le capital et le travail en est une autre ». Il est clair qu'aucune « main invisible » ne règle ce rapport et que la répartition du revenu dépend d'un rapport de force où chacun est juge et partie. « Où est passé le bien commun ? » - Ch VI Rapports de forces et bien commun - « La situation » – p.158.
- LLL, Les Liens qui Libèrent, 2010. Mais aussi à la synthèse « Pour que l'économie retrouve la raison » par Claude Mouchot (coord.) Ed. Economica, 2010, 230 p., qui insiste sur la « déraison » d'une économie au service de ceux qui ont les moyens plus qu'au service de ceux qui manquent de tout, une réflexion économique mettant en scène un Homo economicus entièrement guidé par son seul intérêt et une gestion au service de la finance plus qu'au service des « parties prenantes ».
- idem - Ch VI Rapports de forces et bien commun - « La situation » – p.159-161.
- Comme François Flahault le développe (en p.233), la DUDH précise dans un second temps les conditions sociales indispensables pour que la Déclaration se réalise. « Ce qui revient à admettre que l'acte moral consistant à reconnaître la dignité d'autrui, tout en étant nécessaire pour que celle-ci se réalise, n'est pas suffisant. » La notion de dignité occupe une place essentielle dans la Déclaration. « L'occurrence la plus significative se trouve chez Sénèque.(Lettres à Lucilius, in Les Stoïciens) ». Comme l'a souligné Alain Supiot, la dignité ne désigne pas un droit parmi d'autres, mais un principe métajuridique qui sert à la base de tout ordre civilisé » (L'Europe gagnée par «l'économie communiste de marché»). « Pour jouir du sentiment que l'on existe, pour être quelqu'un, il faut avoir une place parmi les autres, exister à leurs yeux, être à même de participer à la parole et à d'autres formes d'échange. » p.237 – Annexe 2 - « Sur la notion de dignité » - p.231-241
- idem - « La situation » – p.166.
- idem - Ch VI Rapports de forces et bien commun - « Des remèdes inopérants » – p.171. « L'essentialisation du capitalisme se traduit habituellement par une opposition entre la sphère économique et l'État, le secteur privé et le service public. Ainsi l'économiste Pascal Salin préconise-t-il de revenir au « véritable capitalisme », la crise financière ayant été causée par l'« étatisme » (Le Monde, samedi 20 mars 2010). Voir aussi dans les liens externes la référence « Biens publics, biens collectifs. Pour tenter d'en finir avec une confusion de vocabulaire » fournie par François Flahault (p. 116).
- Le Vol de l'histoire. Comment l'Europe a imposé le récit de son histoire au reste du monde. - Gallimard, 2010, p.148 - Kenneth Pomeranz dans Une grande divergence. La Chine, L'Europe et la construction de l'économie mondiale présente un tableau comparé des ressources mises à profit par les pays européens et par la Chine aux XVIIIe et XIXe siècle qui a pour intérêt de montrer que la recherche du profit fut aussi méthodique en Chine qu'en Europe. - idem - Ch VI Rapports de forces et bien commun - « Des remèdes inopérants » – p.179-183.
- Analyse des causes qui mettent en évidence la raison pour laquelle les marchés financiers, par nature, ne sont pas autorégulateurs, comme le fait André Orléan dans De l'euphorie à la crise : penser la crise financière (édition rue d'Ulm, 2009) - idem - Ch VI Rapports de force et bien commun - « Que faire ? » – p.188,189 – Il est tout à fait étonnant et significatif que François Flahault, avec la crise économique et sociale actuelle, associe Montesquieu l'auteur De l'esprit des lois à l'école française de la Régulation.
- L'Abbé Grégoire, évêque des Lumières, textes réunis par Frank Paul Browman, édition France-empire. 1988, p.63.
- - idem - Ch VI Rapports de force et bien commun - « Que faire ? » – p.190,191 – Bref rappel des événements législatifs : à la suite du mouvement abolitionniste, le deuxième Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 a été adopté par la France sous l'impulsion de Victor Schœlcher après le rétablissement du Code noir par Napoléon Bonaparte par la loi du 20 mai 1802.
- Voir Markus Rediker et Peter Linebaugh, L'Hydre aux mille têtes. L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire, édition Amsterdam, 2008.
- - idem - Ch VI Rapports de force et bien commun - « Que faire ? » – p.194,195.
- L'esclavage ne fut définitivement supprimé au Brésil qu'en 1888. Aux États-Unis, après la guerre de Sécession, la ségrégation raciale prit le relais de l'esclavage, d'où les luttes pour les droits civiques dans les années 1950 et 1960.
- - idem - Ch VI Rapports de force et bien commun - « Que faire ? » – p.192 et 197-199.
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la recherche :
- Notices d'autorité :
- Fichier d’autorité international virtuel
- International Standard Name Identifier
- Bibliothèque nationale de France (données)
- Système universitaire de documentation
- Bibliothèque du Congrès
- Gemeinsame Normdatei
- Bibliothèque royale des Pays-Bas
- Bibliothèque nationale d’Israël
- Bibliothèque universitaire de Pologne
- Base de bibliothèque norvégienne
- WorldCat
- Les « biens communs » de François Flahault sont chez les économistes appelés « biens collectifs ». Biens publics, biens collectifs. Pour tenter d'en finir avec une confusion de vocabulaire- par Alain Beitone - Revue du MAUSS permanente, 27 mai 2010 [en ligne].
- "Aimer son prochain pour l’amour de Dieu. L’essentiel de la morale chrétienne ?" - Critiques, réflexions et questions de Jean-Pierre Siméon à François Flahault au sujet du livre Adam et Ève, la condition humaine dans la Revue du MAUSS permanente, 24 mars 2009 [en ligne].
- Ni dieu, ni maître, ni impôts par François Flahault sur la romancière Ayn Rand - Le Monde diplomatique Archives — août 2008.
- Les biens communs vécus, une finalité non utilitaire - Revue en ligne Développement durable et Territoires.
- Trois questions au sujet de Be Yourself par Magali Sarazin du CNRS
- Les conditions sociales de l'individu et de l'économie - Jean Zin
- La revue Semen a mis en ligne un dossier (novembre 2005) sur Le rapport de place dans l'épistolaire à partir de l'analyse d’interactions verbales développée par François Flahault dans La Parole intermédiaire.
- "La fiction, dehors, dedans" - François Flahault et Nathalie Heinich - La revue L’Homme, "Vérités de la fiction" numéro 175-176 juillet/décembre 2005.
- Identité et reconnaissance dans les contes - CAIRN - Revue du Mauss 2004- 1 (n° 23)
- Le portail de revues scientifiques Persé rend disponible en ligne plusieurs articles de François Flahault en particulier sur Communications
- Exposition BnF – Il était une fois ... les contes de fées – Le Chaperon rouge – Clés de lectures : François Flahault
- Travaux explicitement influencés par F. Flahault : un texte du politologue Gildas Renou à propos de la vague de suicides à France Télécom publié en 2009 ; un article du philosophe Lorenzo Vinciguerra sur "les trois liens anthropologiques" chez Spinoza paru dans la revue L'Homme en 2009 .
- Portail de la philosophie
- Portail des sciences humaines et sociales