Kamaʻehuakanaloa
Le Kamaʻehuakanaloa (anciennement Lōʻihi) est un volcan sous-marin situé à environ trente kilomètres au Sud-Est de l'île d'Hawaï. Il est le plus jeune volcan du point chaud de l'archipel d'Hawaï. Auparavant nommé Lōʻihi, terme hawaïen signifiant « long » en français, le volcan est renommé Kamaʻehuakanaloa en 2021 par le Hawaiʻi Board on Geographic Names[2].
| Kamaʻehuakanaloa | ||
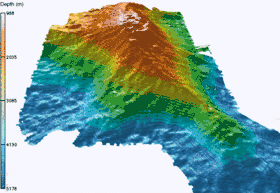 Vue tridimensionnelle du Kamaʻehuakanaloa. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | −969 m | |
| Massif | Île d'Hawaï | |
| Coordonnées | 18° 55′ nord, 155° 16′ ouest | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| État | Hawaï | |
| Comté | Hawaï | |
| Géologie | ||
| Âge | 400 000 ans | |
| Type | Volcan de point chaud | |
| Activité | Actif | |
| Dernière éruption | Début 1996 - 9 août 1996 | |
| Code GVP | 332000 | |
| Observatoire | Observatoire volcanologique d'Hawaï[1] | |
| Géolocalisation sur la carte : Hawaï
| ||
Présentation
Le Kamaʻehuakanaloa s'organise le long d'un rift long d'une trentaine de kilomètres, orienté nord-ouest - sud-est et situé sur le flanc de la partie immergée de l'île d'Hawaï. Le sommet du volcan est formé d'une caldeira de 2,8 kilomètres de large sur 3,7 kilomètres de long comprenant trois cratères en forme de puits. Un de ces cratères, le puits de Pélé, s'est formé en juillet 1996. Il a un diamètre de 600 mètres et est profond de 300 mètres. L'activité volcanique produit des pillow lava et des cheminées hydrothermales éjectant des eaux à 160 °C et où vivent des bactéries chimiosynthétiques et des organismes thermophiles.
Histoire éruptive
Avant les années 1970, il n'était pas connu pour être actif et il était considéré comme un mont sous-marin quelconque. Ce n'est que lorsque des scientifiques se sont intéressés à des séries de séismes localisés au niveau du Kamaʻehuakanaloa qu'ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'un volcan.
En 1996, il a connu une importante éruption avec une intense activité sismique, la mise en place de grandes quantités de lave, la formation du puits de Pélé et l'augmentation de la température des eaux émises par les sources hydrothermales jusqu'à 200 °C. Cette éruption est considérée comme la première mise en évidence directe d'une activité volcanique chez un volcan sous-marin.
L'observation du volcan se fait principalement depuis la surface à l'aide de sismographes, de radars et d'images satellites. Quelques plongées en sous-marin ont eu lieu afin d'obtenir quelques photographies, des relevés de température et des échantillons de roche.
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lōʻihi Seamount » (voir la liste des auteurs).
- Site Internet de l'observatoire volcanologique d'Hawaï.
- « Volcano Watch — Kamaʻehuakanaloa — the volcano formerly known as Lōʻihi Seamount | U.S. Geological Survey », sur www.usgs.gov (consulté le )
Voir aussi
Bibliographie
- (en) C. Ian Schipper, James D. L. WhitecBruce et F.Houghton, « Textural, geochemical, and volatile evidence for a Strombolian-like eruption sequence at Lō`ihi Seamount, Hawai`i », Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 207, nos 1-2, , p. 16-32 (DOI 10.1016/j.jvolgeores.2011.08.001)
Articles connexes
Liens externes
- Portail du volcanisme
- Portail du monde maritime
- Portail d’Hawaï
