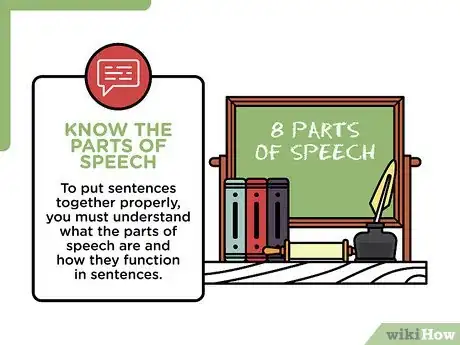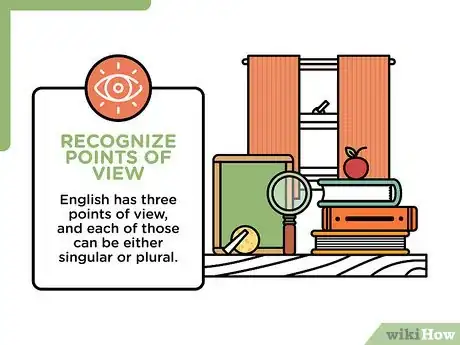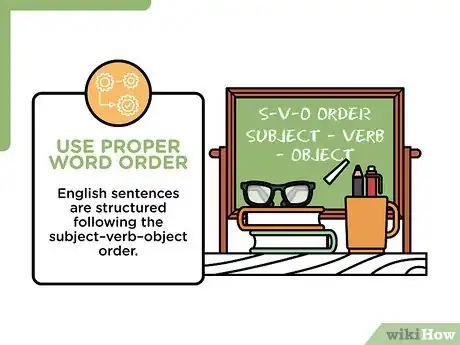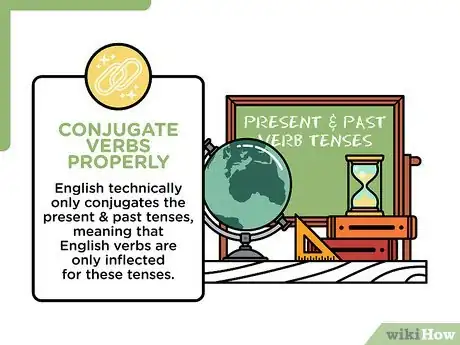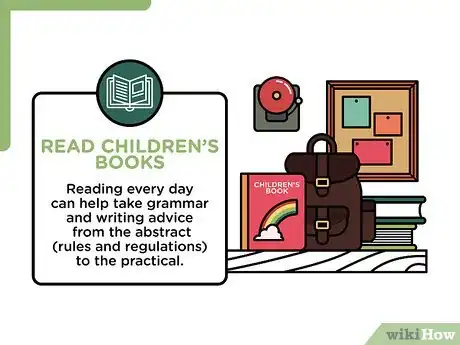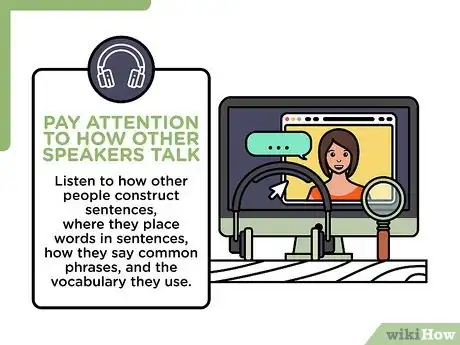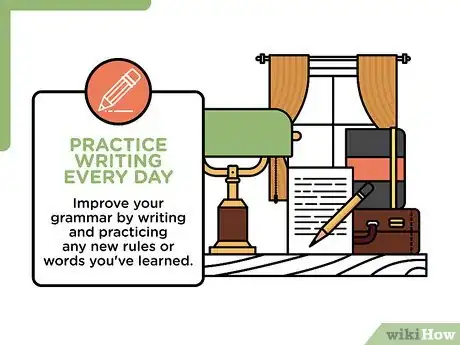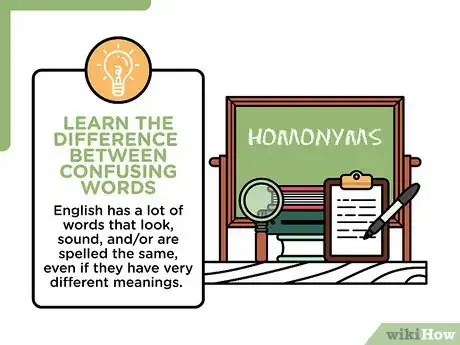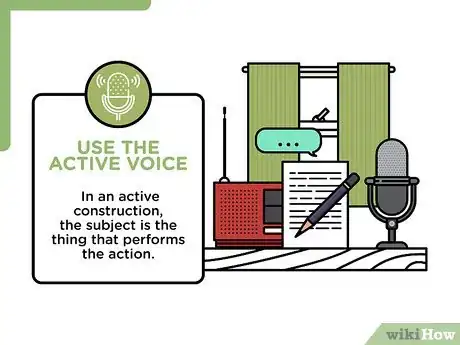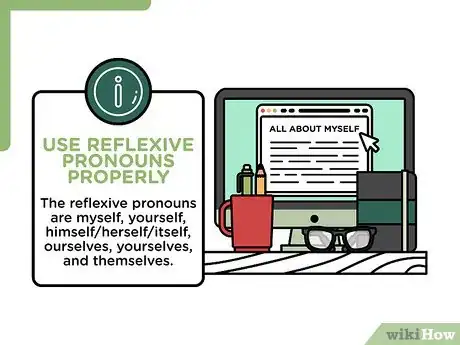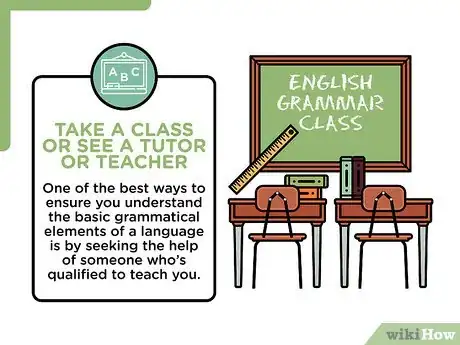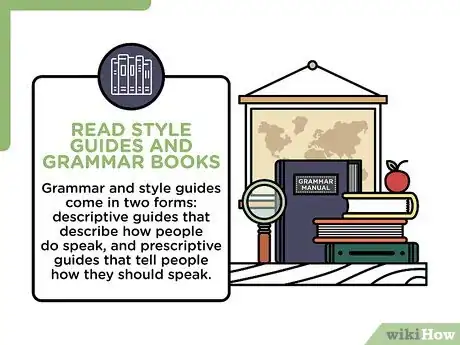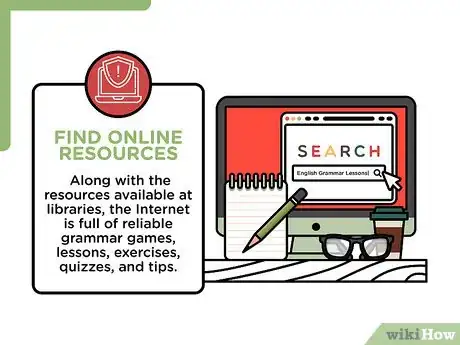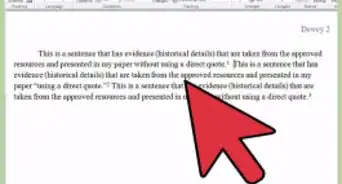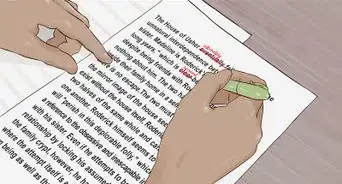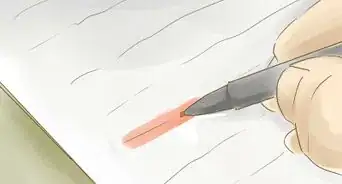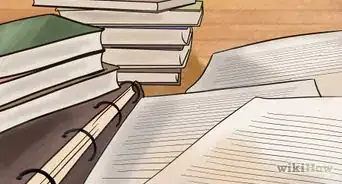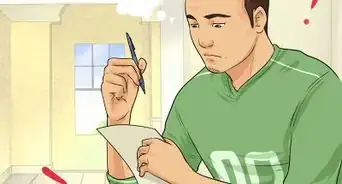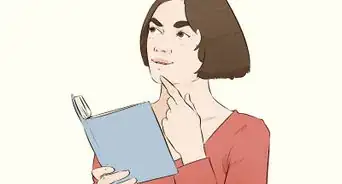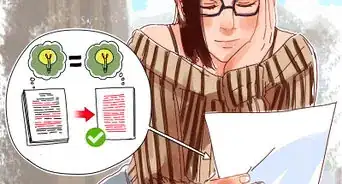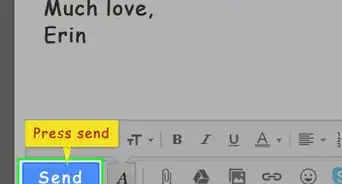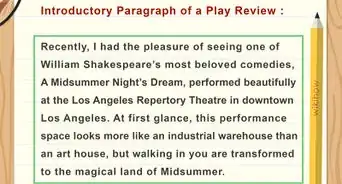Cet article a été coécrit par Grant Faulkner, MA. Grant Faulkner est directeur exécutif de National Novel Writing Month (NaNoWriMo) et cofondateur de 100 Word Story, un magazine littéraire. Grant a publié deux livres sur l'art d’écrire. Ses travaux ont été également publiés par le New York Times et Writer's Digest. Il coanime Write-minded, un podcast hebdomadaire sur la création littéraire et l'édition, et détient un master en création littéraire obtenu à l'université d'État de San Francisco.
Il y a 7 références citées dans cet article, elles se trouvent au bas de la page.
Cet article a été consulté 25 589 fois.
La grammaire est l’ensemble des règles (et de leurs exceptions) qui structure une langue et bien entendu, chaque langue possède sa propre grammaire. Elle n’est qu’une partie de la langue, avec la syntaxe et l’orthographe. La langue française évolue avec de nouveaux mots, la grammaire évolue aussi, mais plus lentement. C’est grâce à une grammaire commune que des locuteurs d’une même langue peuvent se comprendre. Même pour quelqu’un de lettré, la grammaire française reste difficile, car elle repose sur de nombreuses règles et conjugaisons. Pour bien parler cette langue, il faut étudier et lire souvent.
Étapes
Partie 1
Partie 1 sur 4:Apprendre les bases de la grammaire française
-
1Connaissez les éléments constitutifs des phrases. Une langue est composée de mots qui s’assemblent pour donner des phrases qui ont un sens. Parmi ces mots, citons les substantifs, les adjectifs, les pronoms, les verbes, les adverbes, les prépositions, les conjonctions, les interjections et les articles [1] . il faut aussi compter sur l’agencement des phrases afin d’avoir une écriture ou un discours cohérent.
- Un substantif est un nom commun qui est toujours précédé d’un article. En parallèle, des noms communs existent des noms propres qui désignent des personnes. Comme exemple de noms communs, citons table, mer, idée, grue, pensée… et comme noms propres, Hugo, Bertrand, Sophie…
- Un adjectif est un mot qui, accolé à un substantif, en modifie le sens. Comme adjectifs, citons bleu, petit, carré, courageux, tenace…
- Dans une phrase, les pronoms remplacent les noms. Il y a les pronoms personnels sujets (je, tu, nous…), les pronoms toniques (moi, eux, nous, ils…), les pronoms possessifs (le mien, les leurs, la sienne, le vôtre…) et les pronoms relatifs (qui, que, quoi, dont ou lequel).
- Un verbe s’applique à un sujet. Il donne leur fonction aux autres mots de la phrase. Il y en a des milliers : parler, sauter, gronder, finir…
- Un adverbe est un mot accolé à un autre mot (verbe, adjectif, conjonction…) Il ajoute à ce dernier une détermination. Parmi les adverbes, citons rapidement, extrêmement, tard, loin…
- Parmi les prépositions, il en existe de temps (avant, depuis), de lieu (sur, sous, devant) ou de mouvement (jusqu’à, de, vers).
- Une conjonction est un mot qui unit des noms, des propositions ou des phrases. Celles de coordination unissent deux parties indépendantes : c’est le cas de mais, ou, et, donc or, ni, car. Celles de subordination unissent deux parties dépendantes à l’image de que, quand, afin que, alors que…
- Les interjections expriment les émotions. Elles sont toujours suivies par un point d’exclamation : c’est le cas de Aïe ! Hélas ! Ah !
- Les articles sont de petits mots qui précisent les substantifs. Il y a des articles définis (le, la, les) et indéfinis (un, une, des).
-
2Sachez identifier qui parle ou agit. Pour les substantifs, il existe deux genres (féminin et masculin), deux nombres (singulier et le pluriel) et pour les pronoms personnels, trois personnes (première, deuxième et troisième). Tables est un féminin pluriel, briquet, un masculin singulier. Il en va de même des pronoms personnels :
- première personne du singulier : je,
- deuxième personne du singulier : tu,
- troisième personne du singulier : il ou elle,
- première personne du pluriel : nous,
- deuxième personne du pluriel : vous,
- troisième personne du pluriel : ils ou elles.
-
3Respectez la structure des phrases. Une phrase simple en français est construite sur le principe : sujet, verbe, complément, comme dans « Pierre prend sa fourchette ». On ne dira jamais « sa fourchette Pierre prend ». Les articles se placent avant les substantifs ou les adjectifs, et ces derniers se placent soit avant soit après le substantif qu’ils précisent.
- Pierre (sujet) a écrit (verbe) rapidement (adverbe) une (article) longue (adjectif) lettre (objet).
-
4Faites attention à la conjugaison des verbes. En français, les verbes se conjuguent en fonction de la position dans le temps. Les quatre premiers temps sont construits sur la racine du verbe à laquelle on adjoint une terminaison spécifique. Pour les quatre temps du passé, il faut utiliser un auxiliaire (être ou avoir). Les verbes appartiennent à trois groupes et peuvent être conjugués à plusieurs modes. Au mode indicatif, qui comporte huit temps, le verbe manger, du premier groupe, se conjugue ainsi [2] :
- au présent (racine du verbe + désinence) : je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent,
- à l’imparfait (racine du verbe + désinence) : je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, ils mangeaient,
- au passé simple (racine du verbe + désinence) : je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent,
- au futur (racine du verbe + désinence) : je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront,
- au passé composé (avoir au présent + participe passé) : j’ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé,
- au plus-que-parfait (avoir à l’imparfait + participe passé) : j’avais mangé, tu avais mangé, il avait mangé, nous avions mangé…,
- au passé antérieur (avoir au passé simple + participe passé) : j’eus mangé, tu eus mangé, il eut mangé, nous eûmes mangé…,
- au futur antérieur (avoir au futur + participe passé) : j’aurai mangé, tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé…,
- ces huit temps de l’indicatif existent pour tous les verbes du premier, du deuxième ou du troisième groupe, réguliers ou non.
-
5Faites attention à la ponctuation des phrases. La ponctuation est un élément important d’une langue, puisqu’elle marque les débuts, les fins de phrases, mais aussi les pauses à l’intérieur d’une phrase. La première lettre du premier mot d’une phrase prend une majuscule, tout comme les noms propres. Les principaux signes de ponctuation en français sont :
- la virgule qui amène une pause dans la phrase, et ce qui suit précise ce qui vient d’être écrit,
- le point qui marque la fin d’une phrase,
- le point-virgule qui sépare deux propositions indépendantes ou complémentaires,
- les doubles points qui annoncent une citation, une liste ou une explication,
- un point d’interrogation qui termine toujours une question,
- un point d’exclamation qui termine une phrase exclamative ou impérative,
- l’apostrophe qui est la marque d’une élision (lettre qui a disparu),
- les guillemets qui permettent de citer les paroles de quelqu’un d’autre,
- le trait d’union qui unit deux mots afin de former un mot composé,
- les tirets qui sont utilisés dans les dialogues ou pour des énumérations,
- les parenthèses qui permettent d’ajouter telle ou telle précision à un mot ou un groupe de mots de la phrase.
Publicité
Partie 2
Partie 2 sur 4:Pratiquer la grammaire au quotidien
-
1Lisez des livres pour la jeunesse. Si vous ne maitrisez pas très bien la grammaire française, ces livres sont d’un grand secours. Comme ils sont destinés à des enfants, les auteurs font attention à utiliser une langue bien structurée et bien orthographiée. Il y est fait attention à la structure des phrases, à la conjugaison et aux accords. Faites-vous conseiller par votre libraire favori [3] .CONSEIL D'EXPERT(E)Christopher Taylor est professeur adjoint d'anglais au collège communautaire d'Austin au Texas. Il a obtenu son doctorat en littérature anglaise et en études médiévales à l'université du Texas à Austin en 2014.Professeur adjoint d'anglais

 Christopher Taylor, PhD
Christopher Taylor, PhD
Professeur adjoint d'anglaisChristopher Taylor, professeur d'anglais, nous recommande ceci : « lire chaque jour peut vous permettre de mettre en pratique les règles abstraites de grammaire et d'écriture. »
-
2Lisez le plus possible. Pour maitriser une langue, il faut beaucoup lire. Cela permet de connaitre différents styles, d’enrichir son vocabulaire. Lisez des romans, des manuels, de la science-fiction, des biographies, des essais ou des articles [4] . Repérez bien les différentes structures possibles des phrases, l’ordre des mots, l’orthographe… Les romanciers et les poètes prennent, pour les besoins de la cause, des libertés avec la langue.
- Quel que soit votre niveau de français, il est toujours intéressant de lire à voix haute pour s’imprégner de la musicalité de la langue.
- Lorsque vous lisez, ayez toujours à portée de main un dictionnaire.
- Lisez quotidiennement un journal de qualité, écoutez la radio (France Culture) ou suivez le journal télévisé.
-
3Écoutez bien la façon dont s’expriment ceux que vous côtoyez. Faites en particulier attention à la façon dont ils construisent leurs phrases, à la place des mots, au vocabulaire utilisé. Si vous entendez une tournure inconnue, demandez des explications ou regardez dans un manuel de grammaire.
- Faites vôtres des expressions, des tournures ou des mots entendus ici et là afin d’enrichir votre vocabulaire et améliorer votre niveau de langue.
- Tout le monde ne parle pas bien le français, distinguez ceux qui maltraitent la langue et ceux qui la respectent : suivez plutôt les seconds.
-
4Entrainez-vous sur ordinateur. Il y a aujourd’hui de nombreux logiciels (ou applications pour ordiphones) et sites Internet qui permettent d’améliorer sa grammaire [5] . Souvent, ils ont un aspect ludique, mais en général, les erreurs faites vous sont expliquées, ce qui permet de vous améliorer.
- Dans les bibliothèques, les librairies et sur Internet, réservez ou commandez un bon manuel de grammaire, comme le célèbre Bescherelle.
-
5Écrivez tous les jours. Rien ne vaut l’écriture pour parfaire sa grammaire. Prenez le temps d’apprendre de nouvelles règles. Pour cela, ayez un cahier ou un fichier texte de grammaire. Appliquez-vous lors de la rédaction de vos courriels, tout est prétexte à bien écrire.
- Sur ordinateur, ne faites qu’une confiance limitée aux correcteurs orthographiques. Rares sont ceux qui, comme Antidote, font une analyse grammaticale. Si vous faites corriger un texte par un professionnel, profitez de la version corrigée pour en apprendre davantage.
Publicité
Partie 3
Partie 3 sur 4:Éviter les fautes de grammaire
-
1Faites attention aux mots ou locutions prêtant à confusion. Dans toutes les langues, il y a des mots qui prêtent à confusion tant dans leurs écritures que dans leurs sens. Il y a ainsi des mots homographes (qui s’écrivent à l’identique, en se prononçant ou non différemment), homophones (qui s’écrivent différemment, mais se prononcent pareils), hétérotrophes (qui s’écrivent pareils, mais se prononcent différemment) et des homonymes (qui s’écrivent et se prononcent pareillement), ce sont toujours les casse-têtes des langues. Chaque fois que vous les rencontrez, vous devez vous arrêter un instant pour réfléchir.
- Il ne faut pas écrire « c’est pas possible », mais bien « ce n’est pas possible ». À l’oral, l’expression est souvent entendue.
- On confond souvent à l’écrit plus tôt et plutôt. Dans le premier cas, il est question d’une idée de temps, dans le second, d’une préférence.
- Quel que et quelque sont souvent confondus. Suivi d’un verbe, on écrit « quel que » (« Quel que soit le temps… »), suivi d’un adjectif, on écrit « quelque » (« Quelque fastidieux soit le travail… »).
- Source fréquente d’erreurs, c’est (groupe verbal), s’est (auxiliaire d’un verbe pronominal), sais et sait (du verbe savoir) se prononcent tous de la même façon.
- Il ne faut pas confondre à l’écrit ni et n’y. Dans le premier cas, il s’agit d’une conjonction (« ni fromage ni dessert »), dans le second, d’une négation (« Je n’y crois pas »).
- Une des erreurs les plus fréquentes en français est de confondre ces et ses. Le premier est un pronom démonstratif, le second, un pronom possessif. Exemple : « regardez ces livres » (on ne sait pas à qui ils appartiennent) et « regardez ses livres » (ils appartiennent à quelqu’un).
- Le mot courant peut avoir plusieurs sens : substantif, il est la vitesse d’un cours d’eau, verbe, il est le participe présent de courir et adjectif, il signifie banal, usuel.
-
2Utilisez correctement la ponctuation. En français, la ponctuation donne tout son sens aux phrases, c’est pourquoi virgules, points et points virgules ne peuvent pas être utilisés inconsidérément, même si certains écrivains en ont un usage non conventionnel.
- Toutes les conjonctions de coordination sont précédées d’une virgule (« Il est grand, mais vouté »).
- Dans une énumération, chaque élément est séparé par une virgule (« un verre, une fourchette, des couteaux »).
- Le point-virgule est difficile à utiliser. Il permet, entre autres, de mettre en parallèle deux propositions (« Pierre joue au tennis ; son frère pratique le tir à l’arc »).
- Les guillemets sont souvent utilisés à tort. Ainsi, quand vous ne trouvez pas un mot précis, vous écrivez un mot approchant entre guillemets, c’est une faute. Exemple : « un général a fait le break » pour dire « un général a percé les lignes ».
-
3Utilisez la forme active. Dans une phrase à la forme active, le sujet est celui qui fait l’action. À la forme passive, le sujet subit l’action. La forme passive est toujours un peu délicate à manier, car les éléments de phrase sont renversés par rapport à la forme active. C’est ce qui explique qu’elle soit moins utilisée surtout à l’oral. Il n’en reste pas moins que c’est une forme intéressante pour mettre en valeur tel ou tel fait. Pour bien comprendre la différence entre ces deux formes, rien ne vaut des exemples pour saisir : le sens est le même, mais non l’interprétation.
- Dans la phrase à la forme active « je règle la facture », l’accent est mis sur le sujet (je) qui affirme que c’est lui qui a fait l’action.
- À la forme passive, on aurait « la note a été payée (sous-entendu par moi) » le sens en est atténué, celui qui agit passe au second plan.
-
4Utilisez correctement les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont, dans l’ordre des personnes de la conjugaison, les suivants : me (m’), te (t’), se (s’), nous, vous, se (s’) . Ces pronoms sont en fait la première partie des verbes dits « pronominaux » (se demander, se pencher). À ce propos, certains verbes classiques peuvent avoir une forme pronominale (blesser et se blesser), tandis que d’autres verbes n’existent qu’à la forme pronominale (se souvenir, s’enfuir). Enfin, certains verbes ne sont jamais pronominaux (découpler, gambader). Dans certains cas, le pronom réfléchi peut être renforcé par l’adjectif indéfini « même » (lui-même, soi-même).
- Forme pronominale simple : « Je me suis pincé pour vérifier que je ne rêvais pas ».
- Forme pronominale accentuée : « J’ai tenu à me pincer moi-même pour vérifier que je ne rêvais pas ».
- Forme pronominale simple : « Il se demanda comment il aurait régi dans une telle situation ».
- Forme pronominale accentuée : « Je ne sais pas moi-même comment j’aurais réagi ».
Publicité
Partie 4
Partie 4 sur 4:Apprendre la grammaire aux bonnes sources
-
1Suivez des cours de grammaire. Quel que soit votre niveau, il est toujours possible de suivre des cours de grammaire, même au niveau universitaire. Pour cette matière, la présence d’un professeur expérimenté est essentielle. En faculté, il est possible de suivre de tels cours comme étudiant, mais aussi en auditeur libre. Pour les apprenants d’origine étrangère existent quantité de cours de perfectionnement.
-
2Lisez des ouvrages traitant de la grammaire française. Une langue n’est jamais figée, elle évolue en incorporant chaque année de nouveaux mots, il est arrivé aussi, en 1990, que l’orthographe du français se simplifie en adaptant l’écriture au son. S’il y a des changements, il est des points intangibles, comme l’accord des adjectifs, les conjugaisons, l’emploi distinct du « tu » et du « vous » ou encore la concordance des temps. Le français, comme d’autres langues, admet des écarts entre la langue parlée et la langue écrite, les deux pouvant présenter différents niveaux de langage (du simple au plus soutenu).
- La prose est la forme discursive ordinaire. Elle n’est pas astreinte à la versification, mais elle se doit d’avoir des qualités stylistiques.
- Un poème classique se repère à sa métrique, ses rimes et ses strophes. Le genre est contraignant et n’est accessible qu’à ceux qui maitrisent très bien la langue.
- Un poème en vers libre ne ressemble en rien à un poème classique, même s’il possède des longueurs métriques et des effets sonores.
- Un poème en prose ne respecte en rien la versification traditionnelle. Il repose sur des figures de style et des ruptures de construction.
-
3Améliorez votre niveau grâce à Internet. En cherchant bien, vous trouverez des sites de grammaire de tout niveau avec les règles et des exercices. Ces sites font aussi la liaison avec la syntaxe, la linguistique et l’orthographe, car la grammaire n’est que la partie d’un tout.
- Les sites pour s’initier ou se parfaire en français ne manquent pas, certains sont cependant meilleurs que d’autres, comme le site TV5MONDE, le portevoix de la France à l’étranger [6] .
- Il existe aussi des blogues fort intéressants pour se perfectionner ou rafraichir ses connaissances, comme celui de La Langue française [7] .
Publicité
Conseils
- La langue française a une grammaire très compliquée et très rares sont ceux qui la maitrisent parfaitement. Apprenez et vous aurez un niveau de français plus qu’acceptable dans un monde où les fautes pullulent. N’ayez pas peur de bien parler et de bien écrire !
- Si vous connaissez quelqu’un qui maitrise bien la grammaire, n’hésitez pas à lui demander de l’aide et des conseils.
Références
- ↑ http://www.bienecrire.org/grammaire.php
- ↑ https://leconjugueur.lefigaro.fr/regle
- ↑ https://www.decitre.fr/livres/jeunesse/preferes-des-libraires.html
- ↑ https://www.etudes-litteraires.com/forum/topic55702-conseils-de-lecture-pour-ameliorer-son-francais.html
- ↑ https://www.lepointdufle.net/p/grammaire.htm
- ↑ http://apprendre.tv5monde.com
- ↑ http://www.lalanguefrancaise.com