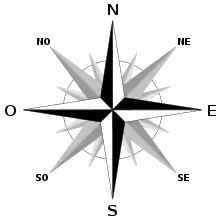Lupstein
Lupstein est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.
| Lupstein | |
 L'église Saint-Quentin. | |
.svg.png.webp) Blason |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Grand Est |
| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |
| Circonscription départementale | Bas-Rhin |
| Arrondissement | Saverne |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Saverne |
| Maire Mandat |
Denis Reiner 2020-2026 |
| Code postal | 67490 |
| Code commune | 67275 |
| Démographie | |
| Gentilé | Lupsteinois, Lupsteinoises [1] |
| Population municipale |
806 hab. (2019 |
| Densité | 103 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 48° 44′ 17″ nord, 7° 29′ 15″ est |
| Altitude | Min. 157 m Max. 234 m |
| Superficie | 7,82 km2 |
| Type | Commune rurale |
| Aire d'attraction | Strasbourg (partie française) (commune de la couronne) |
| Élections | |
| Départementales | Canton de Saverne |
| Législatives | Septième circonscription |
| Localisation | |
Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et appartient au canton de Saverne.
Ses habitants sont nommés les Lupsteinois et les Lupsteinoises.
Géographie
A coté de Lupstein se situe le canal de la Marne au Rhin.

Urbanisme
Typologie
Lupstein est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[2],[3],[4].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 268 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[5],[6].
Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (82,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (47,6 %), prairies (26,7 %), zones urbanisées (8,8 %), zones agricoles hétérogènes (8,6 %), forêts (8,3 %)[7].
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].
Histoire
Pendant la guerre des Rustauds, le , le village, refuge de paysans en révolte qui avaient quitté Saverne, fut brûlé et toute sa population massacrée. On trouve encore aujourd'hui près de l'église un ossuaire qui, selon la légende, contiendrait les os des paysans morts.
Héraldique
.svg.png.webp)
|
Les armes de Lupstein se blasonnent ainsi :
|
|---|
Politique et administration
Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[13].
En 2019, la commune comptait 806 habitants[Note 3], en diminution de 0,25 % par rapport à 2013 (Bas-Rhin : +2,76 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
Lieux et monuments
L'église paroissiale Saint-Quentin
.jpg.webp)
Histoire
Une église est attestée dès 994. L'église actuelle date de 1783-1786, elle est due à François-Antoine Le Roy dont le projet proposait une variante (non retenue) selon laquelle l'ancienne tour-chœur aurait été conservée. Construction du clocher-porche en 1862. Pendant les travaux on découvre des fragments de tympans sculptés du début du XVIe siècle, provenant de l'église antérieure.
Description
Édifice orienté, composée d'une tour-porche Ouest, d'une nef à vaisseau unique, d'un chœur plus étroit et bas, à pans coupés, et d'une sacristie dans l'angle sud-est. Toute l'église est plafonnée. La tour axiale en hors-œuvre (quatre étages) cache en partie la façade avec sa travée centrale de baies à crossettes et son pignon découvert et chantourné. Dans le chœur, décor moderne de tableaux et médaillons peints sur les murs (Annonciation et Apparition du Sacré Cœur à sainte Marguerite-Marie, côté nord ; Apparition de Notre-Dame de Lourdes à sainte Bernadette et Assomption de la Vierge Marie, côté sud) ; décor de stuc sur le plafond (XVIIIe siècle) : coquilles et têtes d'angelots ; vitraux moderne dans toute l'église (les vitraux du chœur, réalisés par les ateliers Ott de Strasbourg, représentent les quatre évangélistes avec divers symboles : saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean).
Mobilier
Le maître-autel a été réalisé par le menuisier Läuffer de Haguenau, en 1784. Sur la porte du tabernacle : l'Agneau couché sur le livre aux sept sceaux (la même thématique est reprise sur le tombeau). Le maître-autel est encore complété d'autres décors : Œil de Jéhovah, têtes d'angelots, trophées liturgiques, blé et raisins. Deux anges agenouillés (bois, polychromie) complètent l'ensemble. Au-dessus du tabernacle figure une huile sur toile (h. 3,80 m) représentant saint Quentin, patron de la paroisse de Lupstein : saint Quentin est agenouillé, un crucifix à la main ; sur le sol, les clous de son supplice ; dans le ciel, ange avec palme des martyrs ; à l'arrière-plan, scène de la décollation du saint.
L'ensemble des deux autels latéraux et retables datent du XVIIIe siècle. L'huile sur toile de l'autel latéral Sud représente saint Sébastien (patron secondaire de la paroisse) attaché à un arbre et transpercé de flèches ; la toile de l'autel latéral Nord représente la Vierge Marie recevant sur ses genoux le Christ mort que l'on vient de détacher de la croix (déploration).
La chaire à prêcher (XVIIIe siècle) comporte une belle représentation du Bon Pasteur (huile sur bois). Au pied de la chaire se trouve le baptistère en grès daté de 1685 ; il est orné de gracieuses sculptures de têtes d'angelots.
La chapelle Ste Barbe au lieu-dit Wundratzheim

Cette chapelle située entre Littenheim et Altenheim appartient au banc communal de Lupstein.
Le village disparu de Wundratzheim
Les travaux des historiens laissent apparaître l’évolution que connaîtra le nom de ce village.
Wundratzheim a existé dès le VIIIe siècle.
La liste des possessions immobilières de l’abbaye de Marmoutier, vers l’an 1000, mentionne le nom de Uundermittesheim. Au XIIIe siècle, le nom du village est écrit Undermuozheim : le 7 juillet 1285, l’évêque de Strasbourg Frédéric de Lichtenberg fit don de ses biens dans les villages de Luthenheim, Luphenstein et Undermuozheim à l’autel de Saint Nicolas de l’abbaye de Neuwiller, pour le salut de son âme et de celles de ses proches. Nous retrouvons Undermutzheim dans un acte de vente daté du 13 novembre 1317, dans lequel Jean de Lichtenberg vendit des biens lui appartenant (environ 9 ha de champs et 11 ha de prairies, situés dans les bans de Littenheim, Lupstein et Wundratzheim). Le village est nommé plusieurs fois encore au courant du même siècle. En 1356, il est question de « in banno ville Wundermotzheim », en 1371 uniquement de son ban, mais en 1392 émerge dans un acte de vente se trouvant à Heidelberg, la mention d’un habitant du village. Il est dit dans cet acte : « Agnes Götze, Clauwes Witwe, verkauft dem Gutknecht Zehen von Altheim und seiner Ehefrau Anna ½ Acker Matten in dem Dürnocke neben des Schulmeisters Kinde von Wilre, ½ Acker Feld am Mühlwege neben Ottemann von Wundermotzheim, alles in Altheim Banne gelegen, für 3 pfund und 5 schillinge Strassburger pfennige. » Une chapelle est, en outre, citée en 1396 (« bi der Capelle zu Wundratzheim »). En 1424, il est toujours question du territoire, mais nous ne trouvons plus trace du village même. Le finage fut annexé à celui de Lupstein et peut-être en partie à celui de Littenheim.
Wundratzheim faisait partie des 28 villages appelés Grafschaftsdörfer. Par ailleurs, il formait avec Littenheim et Lupstein un petit district judiciaire et administratif appelé Büttelei qui était régi par un Schultheiss (ou écoutète), nommé par le possesseur de la Büttelei. L’écoutète présidait le tribunal composé par les échevins élus des habitants des trois villages ; ce tribunal n’avait à connaître que des délits.
Des lieux-dits subsistent : Wundratzheimer Feld, Kirchhöfel, Kapellenbrunnen.
Quel était l’emplacement exact du village? Des restes de maçonneries ont été trouvés lors de travaux pour le drainage des eaux, au lieu-dit Bei dem Bronnen. Il arrivait aussi qu’au moment des labours, des cultivateurs mettaient à jour des pierres pouvant provenir de vieilles constructions dans les parcelles Bei der Capell, conjointes au lieu-dit Bei dem Bronnen, à une distance maximum de 250 mètres de la chapelle. Le village se serait-il étendu au sud-ouest d’une ligne formée par l’axe chapelle-puits ? Nous pouvons le penser.
Vers quelle époque situer la disparition de Wundratzheim ? Le village a-t-il sombré brusquement dans les flots d’une histoire fort agitée, ou s’est-il ruiné peu à peu pour des raisons d’ordre économique et par l’extinction de ses habitants, ses derniers survivants s’étant réfugiés dans les paroisses voisines de Lupstein et de Littenheim ? Nous ne saurions le dire. La peste, qui a sévi en Alsace en 1348-1349, ne saurait être mise en cause. S’agirait-il alors de l’un des nombreux sévices commis par les bandes de mercenaires descendues dans la plaine d’Alsace par le col de Saverne au début du XVe siècle ? La nuit des temps a recouvert l’histoire de Wundratzheim et ne la dévoilera sans doute plus à nos regards.
La chapelle Sainte-Barbe
La chapelle s’élève non loin de la route départementale 151, entre Altenheim et Littenheim, à environ 500 mètres, et à l’ouest, de ce dernier village. Représente-t-elle l’ancienne église de Wundratzheim ou n’a-t-elle été construite que plus tard, sur son emplacement, ou même tout simplement en exécution d’un vœu de quelque habitant ? Si on ne connaît pas la date de construction de cette petite chapelle, on sait qu'elle a subi une restauration durant la seconde moitié du XIXe siècle : c’est ce qu’indique l’inscription « N.L. 1862 C.G. » figurant sur la seule fenêtre cintrée de l’édifice.
De nombreux travaux ont lieu en 2014 et 2015. Ils ont été menés par les Amis de la chapelle Sainte-Barbe, association créée à ce moment-là (inscription au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Saverne, le 24 mars 2014 - Volume 43, Folio 57) : stabilisation des fondations de la chapelle, installation d’une nouvelle charpente et d’un auvent plus spacieux, mise en place de deux niches pour les statues de la Vierge de Lourdes et du Bon Pasteur, travaux de crépissage et de peinture, confection d’une nouvelle porte et de bancs, rénovation de l’autel, aménagement des abords du sanctuaire. Le clocheton et la cloche Ut unum sint ont été ajoutés à ce moment-là.
Ne manquons pas de citer un intéressant document de la fin du XVIIe siècle. L’abbé Jean Jost, curé de Littenheim, nous apprend que la chapelle Sainte-Barbe avait souffert durant la guerre de Trente Ans et qu’elle était peut-être aussi avec sa fontaine, un lieu de pèlerinage et de guérison. Certains historiens demeurent cependant dubitatifs au sujet de cette dernière affirmation.
Nous Curé de Deux Villages en bas-Alsace du Baillage de Kockersperg nommé Lupstein et Leuttenheim a tout ceux qui ces presentes lettres veront salut.
Comme yl ia quelque Jour que le Sr Halbwax bourgeois et provost de Luttenheim et comparu par devant nous soubsigné Curé pour la renovation d’un chappele bastie a l’honneur de St: Barbe scituez a un demis lieu dud village et sur le terrain de l’Evesché de strasbourg, nommé la Sainte fondaine et source des medecins, la quele chappele par les tres facheuses gueres a estée Ruinée et comme le Sr Suppliant provost se plaint de ne pas estre suffisant pour achever la Renovation (déja commencee) de cett chapele, il prie tout les fidels chrestiens d’y assister selon leur bon volonté en foy de quoy (comme cest un eure de miséricorde tres considérable de assister au bastiments des Eglises consacré à Dieu). Je certifie et recomende le présent porteur afin que cett renovation commencée a l’honeur de St Barbe puist avec le secour de Dieu et des fidels Chrestiens estre achevée, Esperant que le bon Dieu recompenserat les assistants par les graces en regardent nos prieres lesquelles nous feront pour eux.
Donne a nostre maison paroisial a Luttenheim le 28me May 1698 Jean Jost Curé
La source
À 120 mètres de la chapelle, direction nord-ouest, jaillit une source qui ne s’est jamais tarie.
Au moment des grandes sécheresses, lorsque l’eau n’était plus suffisante pour subvenir au besoin des fermes et à l’arrosage des champs, les villageois voisins venaient s’y approvisionner sans jamais arriver à l’épuiser.
L’année 2016 a été marquée par l’aménagement d’un chemin menant jusqu’à la source et la mise en place d’un puits en grès rose. Le parcours a été agrémenté par l’érection d’un calvaire et la construction d’un oratoire abritant une statue de saint Antoine ermite. L’endroit est paisible et propice à la méditation. Par la suite un pont enjambant les deux rives a été construit.
Sources :
G. DORSCHNER et F. EYER, « Notes sur Wundermutzheim, village disparu de la région de Dettwiller », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne (SHAS) n° 49-50, 1965.
A. HUMM, « Villages disparus d’Alsace », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs (SHAS) n° 37-39, 1962.
Archives de la paroisse de Littenheim.
Personnalités liées à la commune
Aloys Kayser (1877-1944)
Aloys Kayser est né le à Lupstein, petit village d'Alsace faisant alors partie de l'Empire allemand, depuis le et restitué à la France à l'issue de la Première Guerre mondiale. Sa langue maternelle est l'alsacien, langue proche de l'allemand. Il fait ses études en allemand. Ordonné prêtre le , à Paderborn, Aloys Kayser célèbre sa première messe à Lupstein, le [16].
Missionnaire à Nauru (Pacifique)
Aloys Kayser est envoyé comme missionnaire catholique à Nauru, une colonie allemande du Pacifique, par la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur, une congrégation française. Il s'installe au village d'Ibwenape dans l'actuel district de Meneng et a alors pour mission d'évangéliser la population en concurrence avec le missionnaire protestant Philip Delaporte avec qui il aura d'âpres controverses, les deux missionnaires étant tous deux devenus des experts de la société nauruane. Parallèlement à ses activités religieuses, il étudie le nauruan et publie un dictionnaire nauruan/allemand et une grammaire nauruane.
À l'issue de la Première Guerre mondiale, la colonisation allemande de Nauru prend fin et Aloys Kayser en est expulsé, en tant que citoyen allemand. Il parvient néanmoins à revenir dans ce territoire désormais sous juridiction australienne en 1921 de manière individuelle avec désormais un passeport français. En 1928, il reçoit officiellement de la part du père australien Thomas J. O’Brien une mission des Missionnaires du Sacré-Cœur. En 1936, il permet l'installation de sœurs sur l'île.
Déportation
Aloys Kayser et son collègue de nationalité suisse, le père Pierre Clivaz, sont parmi les quelques occidentaux à rester sur place après l'évacuation des étrangers effectuée par Le Triomphant en . Les japonais débarquent en août, Kayser et Clivaz sont autorisés à continuer leur travail mais le , ils sont déportés ainsi que plusieurs centaines de Nauruans dans les îles Truk à des milliers de kilomètres de Nauru. Les deux prêtres sont sévèrement torturés le par les Japonais qui soupçonnent la communauté nauruane de détenir un poste radio. Interrogés et battus en alternance pendant trois heures, ils sont accusés d'être à la tête de conspiration et de détenir des armes. Ils sont ensuite attachés à des cocotiers et laissés là pendant des heures sous le soleil et sans eau. Ce traitement portera un coup fatal au père Aloys Kayser âgé de 67 ans et en bonne santé avant son arrestation. Il se plaint par la suite de douleurs abdominales et ne peut plus manger. Deux semaines plus tard, il s'alite et meurt le . Le père Clivaz donnera par la suite un témoignage complet sur cette affaire aux enquêteurs américains. Deux des officiers responsables de ce crime de guerre seront condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement.
Voir aussi
Notes et références
Notes
- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.
Références
- https://www.habitants.fr/bas-rhin-67
- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )
- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.
- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).
- [PDF] Liste des maires au 1 avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.
- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).
- L'organisation du recensement, sur insee.fr.
- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
- Photo du mémorial érigé à Nauru en la mémoire d'Alois Kayser indiquant les dates et les lieux de sa naissance et de sa mort
Liens externes
- Portail des communes de France
- Portail du Bas-Rhin