Cinéma japonais
Le cinéma japonais a une histoire qui date des débuts du cinéma. C'est actuellement le troisième cinéma mondial pour le nombre de films produits derrière le cinéma indien et le cinéma chinois[1].

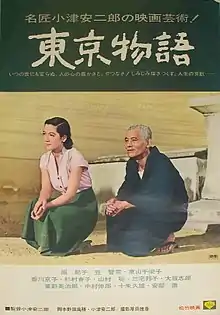

Histoire du cinéma japonais
Les débuts
Les premiers films, ceux de Thomas Edison qui adopte le mot anglais film pour désigner les bobineaux enregistrés avec la première caméra de cinéma, le Kinétographe, par son assistant William Kennedy Laurie Dickson, sont connus des Japonais dès car ils sont présentés à Kobe[2] à l'aide des kinétoscopes, les appareils de visionnement individuel mis au point par Dickson d'après les croquis de l'industriel américain[3].
Puis ce sont deux opérateurs des frères Lumière, Gabriel Veyre et François-Constant Girel, qui organisent des projections sur grand écran à Osaka en 1897 à l'aide d'un cinématographe[2]. Une présentation du vitascope qu'Edison aligne contre ses concurrents français est faite à Osaka puis à Tokyo, mais la première caméra importée au Japon par Shirō Asano porte la marque Lumière.
C'est Shibata Tsunekichi qui commence à tourner les premiers films : il s'agit de scènes de rues et de geishas[4].
Le cinéma muet et les débuts du cinéma parlant
La première star japonaise est un acteur de kabuki, Matsunosuke Onoe, qui apparaît dans près d'un millier de films entre 1909 et 1926. La première actrice reconnue est la danseuse classique Tokuko Nagai Takagi, qui apparaît dans quatre films produits par la compagnie américaine Thanhouser entre 1911 et 1914[5].

Shōzō Makino popularise le genre jidaigeki. Il tourne en décors naturels, prologue à la sortie du film japonais de l'univers théâtral. Les films sont encore muets, et les cinémas emploient des benshi, qui commentent ou interprètent la bande-son des films, parfois accompagnés de musique jouée par un orchestre. Leur grande popularité explique en partie le retard du Japon à passer massivement au cinéma parlant dans la seconde moitié des années 1930. Il ne subsiste que très peu de films de cette époque, car ils ont été détruits par le tremblement de terre de 1923 ou les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le séisme de 1923 inspire des mélodrames larmoyants comme La chansonnette du passeur de Daisuke Itō.

Daisuke Itō est peut-être le premier cinéaste, au sens d'utiliser le médium cinéma comme expression artistique en tant que telle et non seulement comme une production industrielle, lorsqu'il réalise en 1927 Journal de voyage de Chûji, après avoir écrit de nombreux scénarios de commande. Au même moment Teinosuke Kinugasa, acteur de kabuki, réalise des films marqués par une forte influence européenne. C'est le temps des films « à tendance » qui, sur fond de crise économique et sociale, tentent d'illustrer les conséquences négatives et contradictions du capitalisme avant que la censure ne mette fin à cette ambition critique.
C'est ce contexte qui favorise l'émergence ou impose une autre orientation : libéré des contraintes figées du théâtre, l'intérêt pour la vie quotidienne au sein du foyer japonais se développe afin d'éviter les thèmes idéologiques. C'est le début du premier âge d'or du cinéma japonais, avec Gosses de Tokyo de Yasujirō Ozu (1932), L'Élégie d'Osaka et Les Sœurs de Gion de Kenji Mizoguchi (1936).
En 1936, les studios de la compagnie Shōchiku quittent le quartier de Kamata à Tokyo pour s'installer à Ōfuna (ja), dans la préfecture de Kanagawa, et commencent à promouvoir des stars comme Kinuyo Tanaka ou Hiroko Kawasaki[6].
Le , des officiers fomentent un coup d'État qui échoue mais qui symbolise l'essor inexorable du militarisme. La veille, l'Association des réalisateurs japonais était fondée, ce qui permet à Tomu Uchida de réaliser Le Progrès éternel (1937) sur une idée d'Ozu, au moment même où débute la guerre sino-japonaise. En 1937, Sadao Yamanaka réalise son dernier film, Pauvres humains et ballons de papier, tenu par Kiyoshi Kurosawa comme le chef-d'œuvre du cinéma japonais, œuvre dominée par le thème de la mort. Yamanaka meurt l'année suivante sur le front chinois, à 28 ans.
Pendant la guerre
Au début de la guerre sino-japonaise, une loi mettant la production cinématographique sous contrôle du gouvernement est mise en place le . Les professionnels doivent avoir une autorisation du pouvoir japonais. Ainsi, la censure est appliquée avant même les tournages[7]. Cette même année, Le Goût du riz au thé vert de Yasujirō Ozu ne passe pas cette censure préalable ; décrire l'oisiveté de femmes bourgeoises n'est pas autorisé en temps de guerre. En 1940, les autorités vont jusqu'à interrompre une projection du documentaire Les Soldats au combat et retirer son droit d'exercer au réalisateur Fumio Kamei pour ses idées marxistes[8].
Le chef-d'œuvre de Tomotaka Tasaka, Terres et soldats (1939), décrit les souffrances de la guerre tout en exaltant le militarisme nippon[9].
Des films ne parlant pas directement de la guerre sont acceptés comme la trilogie de l'art réalisée par Kenji Mizoguchi d'après des scénarios de Yoshikata Yoda : Conte des chrysanthèmes tardifs (1939), La Femme de Naniwa (1940) et La Vie d'un acteur (1941) sont une apologie du sacrifice de soi, finalement proches des thèmes des films militaristes[10].
En 1941, alors que la guerre prend de l'ampleur, le « Bureau d'information publique » veut limiter la production en ne gardant que deux geki eiga (films de fiction) par mois produits par deux compagnies seulement, alors que la Nikkatsu, Shōchiku, Tōhō, Shinko et Daito présentent alors environ un nouveau film par semaine. Les différentes compagnies sont fusionnées en deux compagnies : la Shōchiku et la Tōhō. Néanmoins, Masaichi Nagata de Shinkō Kinema intervient pour permettre la création en 1942 de ce qui deviendra la Daiei[11]. Beaucoup de professionnels abandonnent leur emploi. Les jeunes employés partent à la guerre. Dans les territoires occupés comme les Philippines, l'Indonésie ou la Mandchourie, des films de propagande sont tournés[11].
Kajirō Yamamoto réalise des parodies avec le comique Enoken avant de réaliser des films de propagande militaristes dans lesquels sont expérimentées des techniques de prises de vue qui seront reprises sur le plateau des Godzilla.
Tous les genres contribuent à la propagande. La Vengeance des 47 rōnin (en deux parties, 1941-1942), un reshiki-geki (dramatique historique) fleuve de 3 h 35 de Mizoguchi, reconstitue très esthétiquement l'histoire célèbre des 47 rōnin. Ozu tourne en 1942 Il était un père qui décrit un père ayant un sens élevé de ses responsabilités. Le scénario est donc conforme aux idées de l'État dans la guerre bien que le scénario ait été écrit en 1937. Keisuke Kinoshita cède lui aux exigences de la propagande avec, en 1943, Le Port en fleurs, tout en réalisant une comédie populaire. Mais son manque d'enthousiasme militariste l'écartera de la réalisation de Kamikazes, un film patriotique[12].
En 1943, l'exemption de service militaire pour les étudiants est levée. En 1945, neuf membres de la compagnie de théâtre Sakuratai meurent dans le bombardement d'Hiroshima.
L'après-guerre
À la censure japonaise succède la censure imposée par les Américains. Akira Kurosawa fait ses débuts comme assistant de Kajirō Yamamoto durant la guerre. En 1946, sort Je ne regrette pas ma jeunesse, virulente critique du système qui vient de s'écrouler. La même année, Keisuke Kinoshita, qui a aussi débuté durant la guerre, réalise Le Matin de la famille Osone.
En 1951, Rashōmon, avec la star Toshirō Mifune, reçoit le Lion d'or à Venise puis l'Oscar du meilleur film étranger. Cette récompense stimule l'ambition en berne des aînés. Les Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi (1953) et Les Sept Samouraïs (1954) de Kurosawa sont récompensés par un Lion d'argent à la Mostra de Venise. Masaki Kobayashi reçoit le Prix du jury du Festival de Cannes pour Hara-kiri en 1962. C'est le deuxième âge d'or, dans lequel Mikio Naruse trouve sa place. Avec une grande économie d'effet, il se plaît à dépeindre une société japonaise en mutation, où transparaît son attention à la condition de la femme japonaise.
Les studios tournent également de très nombreux films de genre. C'est le début des kaijū-eiga (films de monstres) avec Godzilla d'Ishirō Honda en 1954. Durant l'après-guerre, la Nikkatsu qui s'était limitée à la distribution après 1941 distribue des films américains puis décide de produire de nouveau des films. De nouveaux studios Nikkatsu sont construits en 1954 dans la banlieue de Tokyo[13]. La Nikkatsu lance la star Yūjirō Ishihara avec l'adaptation de deux romans de Shintarō Ishihara, un écrivain de la « génération du soleil » (taiyōzoku) : La Saison du soleil (Takumi Furukawa, 1956) et Passions juvéniles (Kō Nakahira, 1956). Le succès de ces films entraine l'adoption d'une ligne de production de films estampillés Nikkatsu Action, fictions dont le fonds de commerce repose sur la violence et la sexualité débridées de héros de type « jeunes rebelles »[14], notamment dans les pinku eiga (films érotiques).
La nouvelle vague
La nouvelle vague japonaise, contrairement à la Nouvelle Vague française, ne regroupait pas un groupe de cinéastes autour d'une revue ou d'un groupe, mais correspondait au Japon à un terme utilisé par les critiques pour évoquer des cinéastes « rebelles » de la Shōchiku : Nagisa Ōshima, Yoshishige Yoshida et Masahiro Shinoda et en référence à la Nouvelle Vague française. Les trois réalisateurs s'opposaient aux « maîtres » des studios tels que Keisuke Kinoshita et Yasujirō Ozu, accusés de réaliser un cinéma « bourgeois »[15]. Dès son deuxième film, Contes cruels de la jeunesse (1960), qui aborde le renouvellement du traité de sécurité américano-japonais, Ōshima filme une histoire mêlant sexe et crime, des thèmes qui parcourront son œuvre. Le film est retiré de l'affiche après quatre jours et Ōshima quitte les studios pour fonder sa société indépendante. Dans le même temps d'autres réalisateurs qui ne sont pas passés par les studios se font connaître, comme Susumu Hani et Hiroshi Teshigahara, qui débutent en réalisant des documentaires. C'est aussi l'essor des productions indépendantes, produites grâce à un système de collaboration entre une petite société de distribution, l'Art Theatre Guild, et une société de production dirigée par le réalisateur. D'autres films sortent selon ce système comme La Pendaison de Nagisa Ōshima en 1968. Ce modèle de financement basé sur de petits budgets permet à de nombreux réalisateurs et à des idées nouvelles d'émerger, comme L'Île nue de Kaneto Shindō.
À la Nikkatsu, Shōhei Imamura tourne Désir inassouvi (Hateshinaki Yokubo) en 1958 ou La Femme insecte (1963), portrait d'une prostituée luttant pour son indépendance, qui sont caractéristiques de son regard d'« entomologiste » de la société japonaise[13].
Alors que la fréquentation totale des salles baisse à partir de 1959, apparaissent des petites sociétés spécialisées dans la production de films érotiques ou pinku-eiga qui attirent un large public. Tetsuji Takechi, critique influent et metteur en scène de théâtre traditionnel, décide de réaliser des pinku : Neige noire est saisi par la police et Tetsuji poursuivi pour violation des lois sur l'obscénité.
En 1968, Seijun Suzuki qui a passé sa carrière à tenter de produire des œuvres stylisées dans le cadre du studio Nikkatsu est mis à la porte à la suite de son film La Marque du tueur. La même année, deux documentaires marquent les esprits : Un été à Narita de Shinsuke Ogawa montre les manifestations de paysans et d'étudiants contre la construction du nouvel aéroport de Tokyo en pleine campagne ; La préhistoire des partisans de Noriaki Tsuchimoto suit le meneur de la rébellion étudiante à l'Université de Kyoto.
C'est à cette époque que Kōji Wakamatsu et Masao Adachi réalisent l'essentiel de leurs films, croisant les codes du pinku eiga, du film de yakuza et la critique sociale virulente.
Les années 1970
En 1971, le premier film de Shūji Terayama Jetez vos livres et descendez dans la rue ! est produit selon le système de collaboration entre une société de distribution et le réalisateur. La même année le critique Eizu Ori écrit à propos de La Cérémonie de Nagisa Ōshima qu'il s'agit d'une synthèse prématurée de la démocratie d'après-guerre. L'époque est au pessimisme : Yukio Mishima s'est suicidé en 1970, en 1971 Masao Adachi part pour le Liban, en 1972 l'Armée rouge japonaise tourne ses armes contre 12 de ses propres membres, les survivants sont ensuite arrêtés à l'issue d'un siège qui bat tous les records d'audience à la télévision. Pour Nagisa Ōshima, c'est la fin du rôle des jeunes dans l'histoire moderne du Japon.
Les films de yakuza ont le vent en poupe : Kinji Fukasaku filme de jeunes délinquants qui enfreignent toutes les règles et par là se condamnent à une mort violente et prématurée comme dans Combat sans code d'honneur.
C'est aussi l'époque des premiers films de la série Otoko wa tsurai yo (C'est dur d'être un homme) de Yōji Yamada, saga populaire aux thèmes universels.
En 1972, la police saisit quatre films roman porno (pinku-eiga de la Nikkatsu) et neuf personnes sont inculpées. Le genre attire néanmoins des créateurs au sommet de leur art. C'est dans ce contexte qu'Oshima réalise en 1976, grâce à un producteur français, L'empire des sens qui repousse les limites de l'expression de la sexualité au Japon. Les livres qui présentent le scénario et des photos du film sont saisis par les autorités japonaises, le film est censuré et n'est jamais sorti au Japon en version intégrale.
Les années 1980
Les années 1980 et 1990 signent la mort du système des grands studios. L'industrie du cinéma se reforme autour de producteurs et de réalisateurs indépendants[16]. Les cinéastes de l'après-guerre continuent de tourner avec des productions souvent non japonaises (Kurosawa en URSS, États-Unis, France ; Ōshima en France). La Ballade de Narayama de Shōhei Imamura gagne la Palme d'or en 1983. Les jidaigeki d'Akira Kurosawa Kagemusha, l'Ombre du guerrier (1980, produit par Hollywood) et Ran (1985, production franco-japonaise[17]) remportent aussi de nombreux prix[18],[19]. Shōhei Imamura gagne une nouvelle Palme d'or avec L'Anguille en 1997.
Tous les réalisateurs apparus après 1980 sont nés après la guerre et n'ont jamais travaillé pour les studios. Takeshi Kitano qui a commencé par des manzai (sketchs de cabaret) sous le nom de Beat Takeshi est engagé par Nagisa Ōshima pour son film Furyo (1983). En 1989, il remplace Kinji Fukasaku pour la réalisation de Violent Cop. Il remanie le scénario en créant son personnage de héros ambigu, dépeignant la société moderne comme règne de la violence instinctive.
Shinji Sōmai dépeint dans Typhoon Club (1985) les affres de la condition des jeunes Japonais désormais voués à la compétition sociale dès leur plus jeune âge et considérés par les producteurs japonais comme une masse se contentant de divertissements violents et/ou érotiques. Il n'y a plus d'alternative à la société capitaliste industrielle moderne. Les taux de suicide explosent.
Les années 1990
Manque de communication, effritement des rapports humains et dissolution des identités sociales sont des thèmes récurrents de cette période.
Le Scintillement de Jōji Matsuoka (1992) évoque une famille qui essaie d'inventer de nouveaux modes de coexistence différents du foyer traditionnel.
Le personnage de Takeshi Kitano dans Sonatine (1993) illustre ce nouveau rapport au monde, problématique et sans repères ; même le gangster violent n'a plus sa place dans la société lorsqu'il est trop vieux. Là encore, la seule issue pour le personnage de Kitano est le suicide.
C'est aussi l'époque de l'émergence de réalisateurs étrangers vivants au Japon, comme De quel côté se trouve la lune de Yōichi Sai (1993) qui est un zainichi, c'est-à-dire un Coréen du Japon.
Alors que les scénarios de films d'horreur étaient jusqu'à présent refusés par les producteurs, à la fin des années 1990 des films d'horreur remportent un succès commercial comme Ring de Hideo Nakata (1997) et/ou un succès critique comme Cure (1997) de Kiyoshi Kurosawa, jusqu'à parfois faire l'objet de l'objet de remake des studios américains. Si les films d'horreur occidentaux sont des références pour ces réalisateurs, ils développent néanmoins un traitement formel qui s'impose comme « histoires de fantômes japonais » ou J-Horror. Ces films caractérisés par une « horreur glacée » ne sont pas sans être irrigués par la description de l'effacement des liens sociaux remplacés par des prothèses électroniques. Dans cette optique, Shin'ya Tsukamoto peut être considéré comme le précurseur thématique, mais pas formel, de ce genre avec Tetsuo (1989), bien que Kurosawa indique que plusieurs de ses scénarios d'horreurs ont été refusés depuis les années 1980. Le cinéma japonais aborde à cette époque des thèmes qui sont en passe de devenir internationaux dans les années 2000, avec le développement et la démocratisation de ce qu'on appelle alors les NTIC pour Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (images numériques, ordinateurs personnels, téléphones portables et Internet).
Les années 2000
Hirokazu Kore-eda, Shinji Aoyama, Nobuhiro Suwa produisent des œuvres influencées par le professeur spécialiste de littérature et de philosophie française Shigehiko Hasumi, et continuent à dépeindre la famille japonaise comme lieu d'expression privilégié des bouleversements de la société dans son ensemble. Kiyoshi Kurosawa, élève d'Hasumi comme Aoyama mais plus vieux peut également être inscrit dans ce mouvement malgré les quelques éléments fantastiques qui servent plutôt de prétextes. Éléments fantastiques abandonnés à la fin des années 2000 dans Tokyo Sonata (2008). Ce mouvement est appelé Rikkyo nūberu bāgu ou Nouvelle vague Rikkyo du nom de l'université dans laquelle enseigne Hasumi, et pour la distinguer de la Shochiku nuberu bagu des années 1960.
Sono Sion se fait connaître avec Suicide Club en 2001, très proche à la fois formellement et thématiquement de ce que fait Kurosawa à la même époque. À partir de 2005 il réalise des œuvres plus originales portant un regard extrêmement critique sur la société japonaise actuelle. En 2012 dans The Land of Hope il aborde la question des conséquences d'une catastrophe nucléaire.
Naomi Kawase est distinguée aussi bien pour ses fictions que pour ses documentaires autobiographiques. Elle est primée dans les festivals les plus prestigieux, notamment le Grand prix au festival de Cannes 2007 pour le merveilleux La Forêt de Mogari.
Après 30 ans d'exil au Proche-Orient et quelques années de prison, Masao Adachi revient à la réalisation en 2005 après avoir été sollicité par des cinéphiles. Au tournant des années 2010, c'est Kōji Wakamatsu qui revient à la réalisation pour quatre films. Il meurt en 2012, renversé par un taxi juste après avoir annoncé sa volonté de réaliser un film sur l'entreprise Tepco et l'accident nucléaire de Fukushima. Leurs films des années 1960 et 1970 sortent pour la première fois en Occident.
Genres
Anime
Après quelques expérimentations au début du XXe siècle, le premier succès populaire du cinéma d'animation japonais (anime) est Astro, le petit robot, créé en 1963 par Osamu Tezuka et encouragé par le lobby nucléaire américain. Mais la reconnaissance internationale de l'anime ne vient que plus tard. Akira de Katsuhiro Ōtomo (1988) a un budget record pour l'animation japonaise[20] et sort ensuite notamment aux États-Unis et en France[21]. Les films du studio Ghibli et ses personnages font alors le tour du monde. Le Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki reçoit le 1er prix du Festival du film de Berlin 2002 et remporte l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Les films de Mamoru Oshii comme Ghost in the Shell sont aussi remarqués et le Festival de Cannes 2004 place Ghost in the Shell 2: Innocence en compétition officielle. Les autres réalisateurs d'anime les plus reconnus sont Isao Takahata, Osamu Dezaki, Yoshiaki Kawajiri, Satoshi Kon, Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai, Hiroyuki Okiura.
Récompenses
Bibliographie
- Max Tessier, Le Cinéma japonais au présent 1959-1979 (sous la dir. de), P. Lherminier, Cinéma d'aujourd'hui No 15, 1979
- Max Tessier, Cinéma et littérature au Japon de l'ère Meiji à nos jours (sous la dir. de), Éditions Centre Georges Pompidou, coll. « Cinéma-singulier », 1986
- Max Tessier, Images du cinéma japonais, introduction de Nagisa Ōshima, Henri Veyrier, 1990
- Max Tessier, Cinéma et littérature au Japon, avec Pierre Aubry, Éditions Centre Georges Pompidou, 1992
- Tadao Satō, Le Cinéma japonais, trad. de Karine Chesneau, Rose-Marie Makino-Fayolle et Chiharu Tanaka, 2 vol., Éditions du Centre Georges Pompidou, 1997, 264 et 324 p.
- Max Tessier,Le Cinéma japonais, Armand Colin, 2005 ; rééd. Armand Colin, 2008 ; 3e édition revue et augmentée par Frédéric Monvoisin, Armand Colin, coll. « Focus Cinéma », 2018
- 100 ans de cinéma japonais (ouvrage collectif), préface de Hirokazu Kore-eda, La Martinière, coll. « Art et spectacle », 2018
- Dictionnaire du cinéma japonais en 101 cinéastes. L'Âge d'Or (1935-1975), sous la dir. de Pascal-Alex Vincent, GM éditions, 2018, 242 p.
Notes et références
- « Quel pays produit le plus de films ? Combien d'écrans 3D dans le monde ? Le cinéma en chiffres. », sur slate.fr, (consulté le )
- Max Tessier, Le Cinéma japonais, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », , 128 p. (ISBN 2-200-34162-8), p. 15.
- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, coll. « Cinéma », , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 15
- Cf. Donald Richie (trad. de l'anglais par Romain Slocombe), Le Cinéma japonais, Paris, Éditions du Rocher, , 402 p. (ISBN 2-268-05237-0), p. 23.
- Aaron M. Cohen Bright Lights Film Journal 30 octobre 2000.
- Tadao Satō, Le Cinéma japonais, tome 1, p. 206 (ISBN 978-2-85850-919-5)
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 208-209.
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 211.
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 214.
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 217.
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 223.
- Tadao Satō, op. cit., tome 1, p. 240.
- La Nouvelle Vague à la Nikkatsu, cinemasie.com
- Antoine de Mena, Nikkatsu : l'histoire d'une major company japonaise
- Max Tessier, La nouvelle vague japonaise, Festival des 3 Continents, 1997.
- Panorama du cinéma japonais des années 1980 et 90, Objectif cinéma
- Company credits for Ran, IMDb
- Récompenses de Ran sur IMDb
- Récompenses de Kagemusha sur IMDb
- Anecdotes d'Akira sur IMDb
- Dates de sortie d'Akira sur IMDb
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Cinemasie : Une base de données sur les cinémas d'Asie et les mangas
- (fr) Mini-documentaire sur Les Génériques du Cinéma Japonais (Blow Up, Arte, 2014)
- Portail du cinéma japonais

